Œdipe et psychanalyse aujourd’hui
« L’ “Homo-psychanalyticus” existe-t-il, analysant sur le divan, ou psychanalyste dans le fauteuil ? Si oui, l’organisation œdipienne fonde-telle son identité, et leurs limites ? Ces questions fondamentales qui sont au centre de l’invention de la psychanalyse par Freud, et du débat qui depuis toujours et inévitablement l’habite et la fait vivante, ont paru, à quelques psychanalystes, suffisamment actuelles et présentes dans leurs pratiques et interrogations quotidiennes, pour mériter, une nouvelle fois, le temps immobile d’une réflexion.
La structure œdipienne est, à la fois, pour tout humain, moment nécessaire de son développement et pour tout psychanalyste, de manière ambivalente, mouvement d’allégeance identificatoire à la découverte freudienne, et de révolte contre le dogme paternel dont est recherché le dépassement. Œdipe, est, en même temps le symbole de la relation de l’homme à son histoire individuelle, et celui de l’analyste au père fondateur de l’analyse. Plus de huit décennies après la découverte – ou là révélation – de ce mécanisme nodal du statut anthropologique de la condition humaine, près de quarante ans après la disparition de Sigmund Freud, les psychanalystes, mélancoliques, n’ont pas encore achevé le travail de deuil, même s’il se manifeste sous les oripeaux colorés et pittoresques d’une dénégation maniaque. Il n’était donc pas indifférent, au, moins pour eux, de réévaluer comment l’œdipe est la mesure de leur liberté, et de leur finitude, dans leur vie personnelle, et dans leur travail clinique et spéculatif. Réunis, il y a quelques mois, pour en discuter, avec la liberté que l’Occitanie a toujours réservé à ses hôtes[1], ils n’ont pas jugé inutile de mettre à la disposition du public, les incertitudes et questions nées de ce débat.
Chacun, à les lire, comprendra peut-être pourquoi. Se contenterait-il de s’interroger, que le but de ce volume serait atteint.
Relire Œdipe
« J’ai trouvé en moi, comme partout ailleurs, des sentiments d’amour envers ma mère et de jalousie envers mon père, sentiments qui sont je pense communs à tous les jeunes enfants… s’il en est bien ainsi, on comprend, en dépit de toutes les objections rationnelles qui s’opposent à l’hypothèse d’une inexorable fatalité, l’effet saisissant d’Œdipe Roi »[2]. « Œdipe qui tue son père et épouse sa mère ne fait que réaliser un des vœux de notre enfance »[3]. Le mythe, la tragédie associés au désir, c’est-à-dire au rêve et au fantasme, voilà notre travail engagé. Si nous avons choisi de nous réunir environ huit décennies après la découverte par Freud, dans son auto-analyse, du principe organisateur de la psyché qui ne prendra que plus tard le nom de complexe d’Œdipe, pour en réévaluer l’actualité dans la psychanalyse d’aujourd’hui, le hasard bien sûr n’y est pour rien. Contournant interdits et censures, le désir cru, chose nouvelle, est présent aujourd’hui sur la scène du monde, les processus primaires valorisés, l’univers de la psychose et de la perversion confondu avec celui d’une illusoire liberté, et les machines désirantes de L’Anti-Œdipe triomphent de la « pourriture œdipienne »[4]. Dans ce mouvement pulsionnel, la structure œdipienne, bien loin de pouvoir prétendre à être noyau irréductible du fonctionnement mental, se trouve reléguée au rang d’un artifice réducteur, artéfact de la névrose de Freud et de l’idéologie dominante de la bourgeoisie viennoise du début du siècle, et depuis lors indûment imposée contre le plaisir des analysants, et contre l’émergence du désir dans la culture. Il s’agit simplement ici de relire la mythologie et les tragiques avec l’aide des travaux d’hellénistes, tel J. P. Vernant[5], de mythologues comme Marie Delcourt[6], ou les philologues germanistes, d’anthropologues ainsi Lévi-Strauss[7], toutes recherches postérieures à Freud. Maintenons dans ce travail présent en nous le doute contemporain sur la validité de l’analyse freudienne du mythe, laquelle est parfois accusée d’avoir en quelque sorte « œdipifié » l’histoire du roi Œdipe. Sans Freud les récits anciens et les tragiques nous conteraient-ils autre chose que certaines péripéties liées au conflit des générations et à la quête du pouvoir ? Avant Freud, Œdipe était-il sans complexe ? C’est ce que nous allons examiner maintenant en étayant cette recherche sur l’approche de deux questions préalables :
– Peut-on repérer la fantasmatique œdipienne dans la mythologie ailleurs que dans le destin tragique du roi de Thèbes ? Notre hypothèse est que le schéma œdipien – l’inceste et le parricide – envahit la mythologie bien avant Œdipe et se perpétue après son aveuglement et l’élection divine à Colone.
– Quel est le lieu géométrique de ces ensembles signifiants que sont le rite, le mythe, la tragédie dans l’histoire des sociétés et des cultures, le rêve, le fantasme, le délire et la créativité dans la vie, de la naissance à la mort de chacun de nous ?
Nous essayerons de montrer comment le mythe est remanié, transformé, par l’anonymat collectif avant que l’inconscient du tragique ne s’en saisisse dans un mouvement qui évoque le travail de production du rêve ou du fantasme.
*
* *
a. Le réexamen de la mythologie trouve une aide précieuse dans une pénétrante étude de Didier Anzieu sur l’interprétation psychanalytique des mythes[8] dont il est utile de rapporter les temps forts, à travers l’exemple de la théogonie selon Hesiode, c’est-à-dire du mythe des origines : du Chaos émerge Gaïa, la Terre mère et féconde. Gaïa aura beaucoup d’enfants : seule, parthénogénétiquement, elle génère le Ciel (Ouranos) qui la recouvre, les Montagnes, et le Flot (Pontos) qui est mâle ; du couple incestueux qu’elle forme ensuite avec Ouranos son fils, naissent les cinq Titans, dont Cronos, les cinq Titanides dont Rhéa et quelques autres dont les Cyclopes. Mais tous ces enfants détestaient leur père, Ouranos, qui leur interdisait l’accès à la lumière et les confinait dans les profondeurs abyssales de la Terre, leur mère. Le plus jeune des Titans, Cronos, armé d’une faucille fournie par sa mère Gaïa, s’approche du couple des parents incestueux au moment où le Ciel recouvre la Terre, c’est-à-dire ou Ouranos se porte sur Gaïa (vision de la scène primitive) et émascule son père dont les testicules tombent au sol et fécondent à nouveau la terre maternelle. Naissent alors les Géants, les Erinyes et les Nymphes des Frênes.
Ainsi apparaissent tout à la fois le désir phallique et incestueux de la mère qui a armé la main du fils et le danger œdipien pour le père. Ouranos châtré, devenu inutilisable, Gaïa s’unit à un autre de ses fils Pontos, rapprochement qui donne naissance aux cinq divinités marines. Quant à Cronos castrateur de son père, il épouse la seconde des Titanides, sa sœur Rhéa, mais se comporte en tyran, refusant de libérer ses frères et sœurs des entrailles de la Terre-Mère, dont il subit dès lors la malédiction : « le sort que tu as fait à ton père Ouranos un de tes fils te le réserve ». Justement alarmé et habilement prophylactique, Cronos entreprend de dévorer chacun de ses enfants aussitôt nés. Après cinq épisodes de ce type, lassée et châtrée à son tour de son désir d’enfants, Rhéa, conseillée par ses parents Gaïa et Ouranos, dissimule Zeus nouveau-né et offre à l’appétit de Cronos une pierre entourée de langes. Plus tard, adulte, Zeus accomplit l’oracle et prend le pouvoir de son père Cronos, que tel Œdipe il n’avait jamais vu, non sans lui avoir fait restituer au préalable, grâce à une drogue vomitive fournie par Métis (la Prudence), sa future épouse, ses frères et sœurs plus âgés et dévorés. Victime à son tour de la même malédiction – l’histoire se répète – qui lui prédit un garçon qui le détrônera, Zeus avale son épouse Métis dès sa première grossesse ; ainsi naîtra directement du crâne du père, Athéna, déesse guerrière armée de la lance et de l’égide, et vouée à la virginité, ce qui doit prévenir toute naissance ultérieure d’un petit-fils grand parricide.
Suppression de la mère, interdiction biologique de fils et petit-fils, inceste et parricide apparaissent comme problématiques, et ses empêchements comme significatifs… Toutefois par la suite, Zeus devait contracter 21 autres unions (6 divines dont naquirent entre autres Aphrodite, Apollon et Arès) et 15 humaines dont, parmi d’autres, Héraclès, Persée, Harmonie, Hélène, Hermès, Dionysos devaient être les fruits. Tous ont des destinées fameuses, mais Arès et Harmonie stimulent plus particulièrement l’intérêt du psychanalyste. Arès, dieu de la Guerre, esprit de la Bataille, se réjouit du carnage et du sang. Monstrueusement grand, père des Amazones et par son union avec des mortelles, de nombre de fils violents et cruels, réputés dans l’attaque, le vol et le meurtre des voyageurs, il apparaît comme le paradigme de l’agressivité violente et primaire, fondamentale. Pour Harmonie, fille de Zeus et d’Electre dans la tradition de Samothrace, elle est, dans la légende thébaine, fille de l’adultère fameux et dévoilé d’Arès et d’Aphrodite, déesse de l’Amour et épouse d’Héphaïstos, premier dieu boiteux d’une lignée que les labdacides enrichiront. De cette union adultérine d’Arès le violent et d’Aphrodite l’amoureuse naîtront cinq enfants équitablement répartis : Éros enfant ailé que les poètes ont décrit comme le désir d’amour, et Antéros son jumeau − en qui Denise Braunschweig et Michel Fain identifient l’amour partagé, « le principe de plaisir du groupe sous l’égide de la loi paternelle,… le représentant des limitations imposées par le groupe à sa sexualité »[9] – portent la marque d’Aphrodite. Deimos la crainte, et Phobos la peur, celle d’Arès dont ils sont les compagnons de combat. La cinquième, une fille, est donc Harmonie, métaphore de la concorde et de l’équilibre, et en qui le psychanalyste identifie aisément un partage égal des investissements agressifs et libidinaux hérités de ses parents. Il ne lui est pas indifférent non plus, qu’épouse de Cadmos elle soit, alliage du désir d’amour et de la violence meurtrière, l’aïeule du Thébain Œdipe. Harmonie nous renvoie par ailleurs à Héphaïstos, époux légitime de sa mère Aphrodite, Héphaïstos en qui Anzieu reconnaît le premier personnage de la mythologie grecque effectivement doté du complexe d’Œdipe.
S’il est en effet le fils du couple incestueux parce que fraternel Zeus-Héra, la légende veut que sa mère le conçut seule, pour se venger des multiples infidélités adultérines de Zeus. Comme Athéna naquit de la tête de Zeus pour qui elle est une fille sans mère, de même Héphaïstos est pour Héra un fils sans père. Par sa naissance parthénogénétique, chacun de ces enfants est donc une défense contre le désir œdipien (encore que la mère d’Athéna eut été Métis…). Prenant plus tard, dans une querelle, le parti de sa mère Héra contre son père putatif Zeus, Héphaïstos projeté par celui-ci, d’en haut vers la mer restera boiteux après cette chute. A l’inverse d’Œdipe, blessé aux chevilles dès l’origine par l’exposition, tuant son père et épousant sa mère dans des actes de la réalité, Héphaïstos répond au désir fantasmatique de la mère d’être son phallus, éliminant le père, qui le punira d’un châtiment équivalent de la castration.
b. Ce simple rappel, où l’inceste appelle sans cesse le parricide ou la castration, parfois latéralisés sur la fratrie, et qui n’est rien d’autre que la retranscription des légendes grecques telles que les philologues et les mythologues ont pu les établir, appelle cependant la critique de Vernant. Il y voit une mythologie « retouchée, coulée de force dans le moule œdipien » ayant perdu son visage, ses traits pertinents et distinctifs. « Impuissante à dire autre chose qu’Œdipe, encore et toujours Œdipe, elle ne veut plus rien dire »[10]. Il lui reproche d’occulter la façon dont « l’ordre a progressivement émergé du Chaos mais sous une forme non encore conceptualisée, les rapports de l’un et du multiple, de l’indéterminé et du défini, le conflit et l’union des opposés, leur mélange et équilibre éventuel, le contraste entre la permanence de l’ordre divin et la fugacité de la vie terrestre ». Ainsi la mutilation d’Ouranos par son fils Cronos a pour résultat que « Terre et Ciel sont alors séparés, chacun demeurant immobile à la place qui lui revient. Entre eux s’ouvre le grand espace vide où la succession du Jour et de la Nuit[11] révèle et masque alternativement toutes les formes. Terre et Ciel ne s’uniront plus dans une permanente confusion analogue à celle qui régnait, avant l’apparition de Gaïa, quand il n’existait dans le monde que Chaos. Désormais c’est une fois l’an, au début de l’automne, que le Ciel fécondera la Terre de sa pluvieuse semence, que la Terre enfantera la vie de la végétation, et que les hommes devront célébrer la hiérogamie des deux puissances cosmiques, leur union à distance dans un monde ouvert et ordonné où les contraires s’unissent tout en restant distincts l’un de l’autre ». Ouranos, fils parthénogénétique de la mère, dont il est à la fois le double et le contraire, répond à un schème de duplication et ne connaît pas la fameuse situation triangulaire. Quant à Cronos il n’a pas accompli le parricide mais la castration paternelle, il n’a pas réalisé l’inceste maternel mais s’est couché dans le lit de sa sœur. Pour Héphaïstos la boiterie évoque-t-elle la castration ? Dans de nombreux folklores, la boîterie est synonyme d’hypervirilité[12]. Certaines versions veulent que ce soit Héra, par dépit, qui projette au sol sa progéniture[13]. Certes Héphaïstos se marie avec Aphrodite mais, « à moins de se vouer à la pédérastie, il fallait bien qu’il s’unisse à une divinité féminine, que l’on pourrait à chaque fois qualifier de substitut maternel… Les Dieux formant sur l’Olympe une seule et même famille, ils n’ont guère le choix qu’entre la mésalliance et l’endogamie ». Le procédé de la substitution lui-même relève peut-être d’une méconnaissance de la fonction de l’avunculat (union de la fille avec l’oncle maternel) et de l’épiclérat (union, imposée par le père, de la fille avec l’oncle paternel de manière à assurer une lignée masculine), considérés par les Grecs comme parfaitement légitimes et n’ayant aucun caractère incestueux.
c. Ces observations ne paraissent pourtant pas décisives et ne permettent sans doute pas de réfuter l’hypothèse dans la mythologie grecque d’un proto-œdipe, en même temps que s’y dévoile le contre-œdipe, le double désir du garçon d’amour pour sa mère, de meurtre pour son père, étant sollicité par l’induction érotique de la mère et la haine destructrice du père. De plus, l’avunculat, comme le remarque Green[14], permet à l’oncle – dans la prohibition de l’inceste maternel – « d’effacer toute assimilation entre le père de la mère, et le père de l’enfant (différence des générations) et de s’inscrire comme figure de ce qui est un jeu dans la génération : ni d’un côté ni de l’autre des deux parents, mais entre eux (différence des sexes). Tout en constituant le système, il révèle l’impuissance de celui-ci à se débarrasser de ce qu’il s’efforce de contenir et de prévenir ». Pour l’épiclérat il permet de scinder la génération de la procréation, « seul le nom du père étant transmis ».
Ces quelques remarques montrent comment le barrage de la censure s’alimente d’objections parfois exactes, mais restant à la surface des choses et s’organisant aisément en rationalisation. Le travail du psychanalyste ici – dans une relecture herméneutique des légendes – à la différence de ce qu’il opère dans la cure où il bénéficie de l’automatisme de répétition, est livré une fois pour toutes à la résistance du critique qu’il ne peut donc entamer progressivement par une élaboration interprétative, d’autant que tout se joue, bien sûr, en l’absence de tout transfert.
Enfin, quant à Œdipe il y a plus : personne, à notre connaissance n’a contesté – ni d’ailleurs relevé avec précision – l’étonnante répétition de la fantasmatique œdipienne dans la proche ascendance et descendance du roi Œdipe lui-même. Qu’on en juge.
Laïos, le père d’Œdipe, dispose de trois images d’identification masculine successives : son père Labdacos (le boiteux) qui décède alors qu’il est encore très jeune ; son grand oncle Lycos, qui l’élève ensuite mais est assassiné par d’autres neveux Zethos et Amphion, vengeant leur mère – on peut imaginer quelle culpabilité inconsciente fut sollicitée chez Laïos par ces deux décès – enfin Pélops, auprès duquel il se réfugie, a été antérieurement tué par son père Tantale, dépecé et servi en ragoût aux Dieux qui dans leur clairvoyance identifièrent le mets humain, reconstituèrent le corps et lui rendirent la vie. Selon certaines versions c’est ce même Pélops qui devait bannir Laïos et le maudire après qu’il ait séduit son fils Chrysippe (d’où la prophétie concernant le destin d’Œdipe), la violence de la réaction de Pélops étant liée à ses propres fixations homosexuelles passives à son père Tantale.
Labdacos, père de Laïos, connut des vicissitudes identificatoires assez voisines : son propre père Polydoros décède avant qu’il n’ait atteint l’âge de un an ; il est recueilli par son grand-oncle Nyctée qui se suicide de chagrin après le départ de sa fille ; c’est enfin Lycos qui l’élèvera et sera plus tard, nous le savons, assassiné par Zethos et Amphion. Au-delà, nous arrivons à Cadmos qui avant d’épouser Harmonie, avait effectué une longue quête errante, en la seule compagnie de sa mère Téléphassa à la recherche de sa sœur Europe, enlevée par Zeus. Voilà pour les ascendants.
Pour la postérité, c’est la triste histoire des fils d’Œdipe, Etéocle et Polynice, maudits par leur père et qui déplaceront en un combat réciproquement fratricide leur haine du père ; quant à ses deux filles, Ismène et Antigone, elles voulurent être ses compagnes jusqu’à l’élection divine de Colone avant d’achever tragiquement leur vie, Ismène assassinée, et Antigone par le suicide auquel la condamne son attachement incestueux pour la dépouille de son frère Polynice, déplacement de son amour œdipien. Le fiancé d’Antigone, Hæmon, après avoir tourné son épée contre son père Créon, responsable de ce suicide se donne à son tour la mort. Nous aurons à nous préoccuper plus loin d’Œdipe lui-même, mais nous pouvons dire dès à présent que la mythologie ante et post-œdipienne annonce et répète sans cesse l’organisation œdipienne.
*
* *
Une deuxième question vient maintenant : comment s’organisent les relations du rite, du mythe, de la tragédie avec le rêve et le fantasme ? Autrement dit, comment aujourd’hui peut-on formuler les fondements d’une théorie psychanalytique du mythe, c’est-à-dire une élaboration qui prenne en compte l’inconscient ? C’est à partir des travaux d’Abraham, de Frömm, de Roheim, d’Anzieu que se dessinent quelques axes. L’essentiel de ces constructions, appuyé sur des exemples cliniques ou culturels qui ne peuvent être développés ici, nous semble résider dans la mise en évidence, au cours du travail de transformation qui du rite donne naissance au mythe, à son tour fixé par la tragédie, des mêmes mécanismes qui sont à l’œuvre dans la genèse du fantasme, du rêve ou du délire.
a. Au début sont les rites, séries d’activités organisées selon un ordre constant et dont le sens n’est donné que par des formules d’accompagnements. Les rites imposent initialement une action pour obtenir un résultat. Ensuite, par une complexification où la compulsion obsessionnelle a naturellement sa part, le rite s’éloigne de son origine et de son but pour ne plus se rattacher qu’à la circonstance ; enfin il s’altère par l’intervention du commandement divin, ou plutôt oraculaire. « Progressivement le rite se rattache non au désir de l’homme, mais à l’histoire du dieu » (A. Green)[15]. Ainsi d’une fonction de maîtrise et de contrôle magique des phénomènes naturels et des angoisses qu’ils suscitent – l’initiation n’étant là qu’un épisode de la physiologie – s’apparentant au cérémonial de la religion, le rite perd peu à peu son sens pour celui qui le pratique et n’est plus agi que mécaniquement.
b. C’est de cette perte du sens que naîtra le mythe, langage qui tout à la fois en transforme le signifiant et conserve le signifié. Le mythe se réfère à un ordre du monde, établit la « loi organique de la nature des choses »[16]. Le mythe à son tour s’altère, se morcelle, se condense, se déplace et finalement se symbolise dans la saisie qui en est faite par les tragiques. « La tragédie rassemble en une cohérence remarquable la vérité du foisonnement mythique ainsi fixé. Le travail sur le mythe qu’opère la tragédie ajoute une déformation supplémentaire à la pensée mythique, mais c’est par la tragédie que se perçoit mieux la vérité dont le mythe est porteur. Sans doute parce que le remaniement incessant des mythes par l’anonymat collectif est ici repéré par l’inconscient individuel du poète tragique » (Green)[17].
c. Le désir qui sourd sans cesse dans cette séquence rite-mythe-tragédie est précisément l’occasion du travail de déconstruction-reconstruction qui, au service du refoulement, transforme et élabore sans répit les contenus. Scénarios imaginaires, déformations par les défenses, émergences d’un désir inconscient, c’est la définition du fantasme ; modelage à travers la condensation, le déplacement, la symbolisation d’un contenu latent en contenu manifeste, c’est le travail du rêve. Une telle description est cependant considérée comme réductrice par Vernant[18] qui tire argument du « brusque surgissement du genre tragique à la fin du VIe siècle, dans le moment même où le droit commence à élaborer la notion de responsabilité en différenciant de façon encore maladroite et hésitante le crime « volontaire » du crime « excusable »… pour en faire un moment historique très précisément localisé dans l’espace et dans le temps, dans la Grèce du tournant du vie au Ve siècle. De la justice du talion des Erinyes au droit plus humain des Olympiens, l’approfondissement de la réflexion philosophique épuise les contradictions, source du tragique, genre qui est par ailleurs totalement ignoré des autres civilisations. Plus qu’à la responsabilité humaine éclairée par la psychologie, Vernant réfère le sens tragique à l’inscription des actes humains dans un univers articulé par les puissances divines et un ordre qui « dépasse l’homme et lui échappe ». Mais n’y a-t-il pas là simplement, comme dans le délire du président Schreber, la description imagée de la force du désir qui s’oppose à la domestication pulsionnelle, condition de la vie sociale, la tragédie permettant en quelque sorte au nouvel homme grec devenu responsable, d’intérioriser le sur-moi jusqu’alors expulsé sur les représentations divines ? De plus s’il est historiquement exact que l’irruption du sens tragique a marqué un moment très fécond précisément situé dans la culture grecque – qui est aussi celui de l’apogée de Périclès – qui nierait aujourd’hui l’actualité de Sophocle, d’Eschyle, d’Euripide, qui affirmerait que devant Œdipe « notre curiosité est purement archaïsante » ? (Green).
*
* *
Comme le refoulé, notre interrogation du début revient maintenant : est-ce Freud qui a doté Œdipe de son complexe ? Ou bien la vie d’Œdipe est-elle assimilable à un rêve, réalisation d’un désir qui franchit la censure, et s’éteint aussitôt du fait d’avoir été posé en acte ? La légende du roi Œdipe est-elle autre chose que le roman familial de la psychanalyse, fantasme et programme commun des psychanalystes ?
Pour les hellénistes il ne fait pas de doute en effet que Sophocle a été en quelque sorte « psychanalysifié de force » par l’interprétation abusive que les psychanalystes ont donné de son texte. Œdipe ignorait et ne pouvait qu’ignorer que Laïos et Jocaste étaient ses vrais parents et tous les actes de sa vie visaient à le protéger du destin funeste que lui annonce l’Oracle. La révélation progressive de son identité réelle dans la pièce répond à une exigence esthétique qui prépare la révélation finale et à une nécessité religieuse : l’Oracle, qui ne peut mentir, doit s’en tenir à une réponse énigmatique. A la question qui lui est faite par Œdipe : « qui suis-je, qui sont mes parents ? », il ne répond pas : « ce ne sont ni Polybe ni Mérope, mais Laïos et Jocaste », il répond : « ton destin est de tuer ton père, et de te coucher dans le lit de ta mère », laissant ainsi ouvert le champ des possibles. Si donc Œdipe se croit vraiment le fils chéri de Polybe et Mérope il est clair qu’il n’a pas le moindre complexe d’Œdipe. Dans ce sens, œuvre aussi le fait que Sophocle n’a rien introduit dans son texte qui puisse suggérer la différence d’âge entre Jocaste et Œdipe, et la placer ainsi dans une position maternisante par rapport à son époux et fils. Freud écrit : « le fait assez bizarre que la légende grecque ne tienne aucun compte de l’âge de Jocaste me semblait s’accorder très bien avec ma propre conclusion que dans l’amour que la mère inspire à son fils, il s’agit non de la personne actuelle de la mère, mais de l’image que le fils a conservé d’elle et qui date de ses propres années d’enfance »[19]. Mais Vernant remarque justement que « précisément Œdipe ne pouvait, de ses années d’enfance, conserver aucune image de Jocaste ». Rappelons en passant que le père de Freud avait vingt ans de plus que son épouse, et que sous le toit familial abritant le jeune Sigmund, trois générations s’interpénétraient en une complexité singulière. Enfin les vers célèbres déjà relevés par Freud « bien des humains ont déjà rêvé qu’ils s’unissaient à leur mère. N’en pas tenir compte rend la vie plus facile à porter »[20], outre la dénégation du sens du désir, renvoient à la valeur oraculaire du rêve, et pour celui d’union avec la mère, de présage d’un événement favorable, à travers le symbolisme de la Terre-Mère, d’où tout naît et où tout revient, de fertilité et de prise de pouvoir (ainsi Hippias marchant sur Athènes, Brutus et les Tarquins devant Rome, César franchissant Ie Rubicon ou débarquant en Afrique, ont-ils fait ce genre de rêve au seuil de la puissance). Toutes ces raisons méritent d’être entendues, mais sont comme l’écume des mots, demeurant si l’on ose dire à la surface de la mer. Pour illustration citons le rôle absolument opposé que le même Sophocle fait jouer à Créon dans Œdipe Roi et dans Antigone : ainsi s’illustre l’utilisation par le dramaturge de la réalité mythique et historique au profit d’une réalité psychique qui invalide les discussions trop subtiles pour savoir ce qu’est la vraie réalité. Car ce que d’évidence sait Œdipe, de la bouche de Laxios, est son destin de tuer son père et d’épouser sa mère. A cela une seule parade : éviter d’entrer en lutte homicide avec un homme pouvant être son père, et en commerce charnel avec une femme de l’âge de sa mère. Il ne le fit pas. Cette méconnaissance tragique, comme celle dont il fera preuve tout au long du texte de Sophocle, s’efforçant sans cesse de dissocier la reconnaissance du meurtre vite pressenti de celle du parricide et de celle de l’inceste longtemps niés, lui, ce « fameux découvreur d’énigmes », n’est pas une méprise mais le dévoilement d’une intentionnalité profonde que révèle peu à peu le texte tragique, comme dans la marche à rebours d’une psychanalyse. « Ce n’est pas de raconter des choses réellement arrivées qui est l’œuvre propre du poète, écrit Aristote[21], mais bien de raconter ce qui pourrait arriver ». Ce qui est arrivé à Œdipe est ce qui pourrait arriver à chacun des humains, sauf bien sûr… aux psychanalystes.
Pour le psychanalyste en effet le personnage le plus original de toute cette histoire n’est pas Œdipe si tragiquement banal – mort dès sa naissance, et immortel dès sa mort – mais le devin Tirésias, auquel Bergeret[22] a consacré quelques réflexions et sur qui nous voulons terminer. Un jour qu’il se promenait sur le Cithéron – là même où fut exposé Œdipe – Tirésias vit deux serpents en train de s’accoupler (la scène primitive). Il les sépare et se transforme en femme. Il lui faut sept années pour éprouver les richesses de sa féminité – une « bonne analyse didactique » note Bergeret – au terme desquelles, témoin de la même scène, et ne craignant pas d’intervenir de la même façon, il reprend son sexe originel. Fameux par cette mésaventure, il est consulté par Zeus et Héra, dans une de leurs disputes pour connaître lequel de l’homme et de la femme, dans la rencontre d’amour éprouve le plus de plaisir. Il répond sans hésiter que si le plaisir se compose de dix parties, la femme jouit de neuf et l’homme d’une seule. Furieuse d’une telle perspicacité révélatrice de la nature du plaisir des Dieux et pour éviter un voyeurisme gênant, Héra l’aveugle. Zeus en compensation met fin à ses « contrôles », lui accorde le don de prophétie, et le nomme en quelque sorte « devin titulaire » avec le privilège de vivre sept générations humaines. Supportant l’angoisse de la scène primitive, capable d’être dans le mouvement du transfert et du contre-transfert à la fois homme et femme, aveugle, c’est-à-dire abstinent, et par son don de prophétie, hors des conflits de pouvoir et de hiérarchie, donc neutre, Tirésias n’est-il pas la véritable image d’identification du psychanalyste ? Qu’une autre version le fasse aveugler par Pallas parce qu’il avait, par accident, vu la déesse toute nue, cela n’évoque-t-il pas une curiosité assumée pour « les secrets du corps de la mère » (Anzieu) ? Dans la tragédie de Sophocle, Tirésias demeure disponible mais n’intervient pas activement, se bornant, devant la fureur et la douleur d’Œdipe, à pointer quelques contradictions de son discours manifeste et à laisser émerger en lui progressivement l’élaboration de son fantasme. Tirésias nous touche enfin en ce qu’il est un psychanalyste imparfait qui à l’occasion ne peut maîtriser l’expression de son contre-transfert. Soumis à l’agressivité projective d’Œdipe qui l’accuse d’avoir ourdi le complot contre Laïos il laisse passer dans un « acting-in » intratransférentiel, d’abord « c’est toi l’impie qui souille cette terre » (v. 353) puis « je dis que tu es le meurtrier que tu cherches » (v. 362)[23]. Lequel de nous n’a succombé, une fois, à cette faiblesse, au moins dans sa psyché ?
*
* *
Si je voulais pour finir ramasser en quelques phrases les idées maîtresses de ce court travail je dirais ceci : la relecture de l’histoire du roi Œdipe dans son contexte mythique, culturel et tragique, à la lumière des recherches postérieures à Freud permet de montrer :
– l’organisation œdipienne fonctionnant de manière répétée dans la mythologie pré et post œdipienne ;
– le déplacement ainsi proposé du débat fameux mais dépassé sur l’universalité de l’organisation œdipienne en une recherche plus contemporaine sur son intemporalité ;
– l’antériorité du contre-œdipe maternel (provocation érotique) et paternel (destruction préventive) sur l’œdipe ;
– l’analogie du travail de remodelage du rite au mythe et à la tragédie avec la transformation du rêve ou l’élaboration du fantasme ; l’ambiguïté singulière enfin de la personnalité du roi thébain qui agit mais ne fantasme pas, à l’inverse du modèle que Sophocle nous propose en Tirésias, clairvoyant dans sa cécité.
Peut-être pouvons-nous trouver dans la figure humaine de cet envoyé des Dieux, le courage d’une certitude tranquille que n’impressionnent pas les proclamations et les menaces des puissants du jour (reliquat de leur mégalomanie infantile), sans oublier tout au long de nos discussions l’humilité apprise de Freud, et qui doit nous conduire à ne pas confondre dans nos constructions théoriques les postulats avec les preuves[24].
Notes
[1] Journées occitanes de psychanalyse, Toulouse, novembre 1977.
[2] Lettre du 15 octobre 1897 de S. Freud à W. Fliess, in Naissance de la psychanalyse, trad. A. Berman, pp. 198-199, P.U.F., Paris, 1956.
[3] L’interprétation des rêves, trad. par L. Meyerson, révisé par D. Berger, p. 229, P.U.F., Paris, 1967.
[4] Deleuze (G.) et Guattari (F.), L ’Anti-Œdipe, Minuit, Paris, 1972.
[5] Vernant (J.P.), Mythe et pensée chez les Grecs, Maspero, Paris, 1965.
[6] Delcourt (M.), Œdipe ou la légende du conquérant, Liège, Faculté de Philosophie et Lettres, Droz, Paris, 1944.
[7] Lévi-Strauss (C.), Anthropologie structurale, Plon, Paris, 1958.
[8] Anzieu (D.), « Œdipe avant le complexe », Les Temps Modernes, pp. 675-715, janv. 1966.
[9] Braunschweig (D.) et Fain (M.), Éros et Anteros, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 1971.
[10] Vemant (J.P.), op. cit.
[11] Ce qui évoque pour nous au passage une des énigmes de la Sphynx.
[12] Mais ne s’agit-il pas d’une dénégation ?
[13] Mais n’y a-t-il pas là, effectivement, une manifestation du dépit amoureux de la mère ?
[14] Green (A.), Un œil en trop. Le complexe d’Œdipe dans la tragédie, Minuit, Paris, 1975.
[15] Green (A.), op. cit.
[16] Grimal (P.), Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, P.U.F., Paris, 1951.
[17] Green (A.), op. cit.
[18] Vernant (J.P.), art. cit.
[19] Freud (S.), Psychopathologie de la vie quotidienne, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 1967.
[20] Sophocle, Œdipe Roi, trad. J. Grosjean, La Pléiade.
[21] Aristote, Poétique, texte établi et traduit par J. Hardy, Belles-Lettres, Paris, 1965.
[22] Bergeret (J.), « Sphinx ou Tirésias », Revue Française de Psychanalyse, t. XXXV, 5-6, p. 921-934, 1971.
[23] Sophocle, Œdipe Roi, trad. J. Grosjean, La Pléiade.
[24] « Notre science comporte un certain nombre d’hypothèses, il est difficile de dire s’il faut les considérer comme des postulats ou comme des produits de nos recherches ». Freud (S.), « Leçons élémentaires sur la psychanalyse », S.E., vol. XXIII, p. 282.
La curiosité à l’égard de Sigmund Freud
Le travail que je vais vous présenter est celui d’une recherche, en cours d’élaboration dont le cadre est tracé, les grands axes d’intérêt déterminés mais où demeurent de vastes zones d’incertitude et des espaces de liberté à reconstruire comme un espace analytique.
Il s’agit en effet de reconsidérer notre rapport œdipien à Freud, mort il y a plus de quarante ans, dont le deuil n’est pas fait par les analystes comme individus, et par la communauté analytique comme groupe ou institution. Je ne peux évidemment pas taire le fait que si cette question me préoccupe depuis un certain temps, je n’y ai vraiment travaillé que depuis un an et demi, c’est-à-dire depuis la mort de mon propre père. Sans doute fallait-il en passer par là d’abord, comme lui-même dut attendre la disparition de son père Jakob pour entreprendre son autoanalyse.
Mon travail s’articulera autour de deux axes complémentaires : une relecture rapide du mythe d’Œdipe tel que nous pouvons le comprendre aujourd’hui, et l’examen attentif de quelques erreurs ou incertitudes significatives dans la biographie officielle, je dirais la mythographie de Sigmund Freud. Une telle démarche analogique est d’ailleurs soutenue par Freud lui-même qui consacre quelques paragraphes de son chapitre sur les erreurs dans Psychopathologie de la vie quotidienne[1] à relever celles qu’il commit dans ses études mythologiques et à les associer à certains événements de sa vie, erreurs toutes liées à une confusion de générations.
J’essaierai de montrer que ce que Freud n’a pas vu, ou n’a pu voir dans la légende, les récits mythiques, ou la mise en forme tragique du drame d’Œdipe est en liaison directe avec les circonstances mal élucidées de sa propre histoire. Ceci ne me semble pas sans conséquence pour nous psychanalystes de la décennie de 1980 car sont remis en question chemin faisant l’abandon de la théorie de la séduction, le statut du fantasme et sur un plan clinique l’articulation du contre-transfert et du transfert. Il s’agit pour nous de reprendre une liberté de penser et d’inventer qui rende sa fécondité au travail des analystes entravés comme l’était Œdipe aux chevilles, par une révérence trop rigide au mythe freudien, et à l’immobilité de sa théorisation.
LA RELECTURE DU MYTHE D’ŒDIPE
Ceux d’entre vous qui ont participé aux Journées Occitanes de Psychanalyse, ou qui me font le plaisir de lire ce que je peux écrire, savent que mon intérêt pour le mythe d’Œdipe est déjà ancien. Dans le cadre d’une recherche plus ambitieuse, j’ai pu déjà en publier quelques éléments qui m’ont paru significatifs. Mais ma surprise réside dans la richesse immense de ce trésor légendaire, mythique et tragique, et dans le fait que son approfondissement ramène toujours à la lumière de nouveaux éclairages, ouvrant des voies inédites de recherche.
Mais pour nous en tenir au cadre de ce colloque, je voudrais dégager les traits les plus pertinents qui viendront articuler ma thèse : si le mythe est la somme des variantes, variations, commentaires, contradictions qui sont parvenus jusqu’à nous, chacun, mythologue, historien, psychanalyste s’en saisit pour ce qui lui est possible. Si les mythèmes travaillent le mythe, le mythe compris dans son acception la plus large travaille en chacun de nous. Et il est intéressant de chercher ce que Freud a omis, occulté, refoulé.
Je ne dispose pas du temps nécessaire pour exposer ici les surprenantes découvertes qui s’offrent à un psychanalyste curieux quand il relit avec attention, et parfois passion le mythe d’Œdipe dans ses multiples variantes qui toutes le constituent.
Je fixerai simplement votre attention pour piquer votre curiosité sur un personnage, curieusement oublié par Freud, le père d’Œdipe, Laïos. De lui je rappellerai seulement :
– ses propres personnages identificatoires ;
– sa conduite de séducteur homosexuel actif et violent ;
– l’acte infanticide d’exposition d’Œdipe ;
– la rencontre mortelle avec Œdipe dans le vallon ombreux.
Les personnages identificatoires de Laïos
Ils sont au nombre de trois : Labdacos, Lycos et Pelops :
– son père Labdacos (le boiteux) décède alors qu’il est encore très jeune ;
– son grand-oncle Lycos l’élève ensuite avant d’être assassiné par d’autres neveux Zethos et Amphion, vengeant leur mère la belle Antiope qui avait été punie par Lycos pour avoir pris un amant avant d’être finalement aimée par Zeus, déguisé en satyre, qui lui donna Zethos et Amphion ;
– enfin Pelops auprès duquel il se réfugie alors. Pelops est le fils de Tantale, victime du célèbre supplice pour avoir révélé aux hommes les secrets dont les Dieux s’étaient librement entretenus devant lui (curiosité et scène primitive), pour avoir dérobé le nectar et l’ambroisie, et enfin pour avoir offert aux Dieux au cours d’un banquet son fils Pélops découpé et accommodé en ragoût.
Après sa résurrection par les Dieux, Pelops fut séduit par Poséidon, et donc offert une deuxième fois aux Dieux, cette fois-ci comme amant. Thanatos et stade oral caractérisent la première manière, Eros et deuxième phase de l’Œdipe (soumission érotisée à l’image du père) la seconde.
La conduite de séducteur homosexuel actif et violent
Laïos se réfugie donc auprès de Pélops et sera maudit par ce dernier pour avoir séduit son fils Chrysippe, le Cheval d’Or, qui, selon certaines versions, se suicida de honte. Ce que Pelops n’accepte pas est la violence déployée par Laïos au cours des jeux Neméens pour s’emparer de Chrysippe, l’acte de force. Dès lors Pélops prononce la malédiction fameuse, funeste et exacte qui veut que Laïos, voleur de son fils, serait à son tour tué par son propre fils, Œdipe, qui est encore à naître, lequel épouserait par la suite sa propre mère. On sait ce qu’il en fut. Ce qui nous importe au point où nous nous trouvons est la raison de la colère extrême de Pelops : il n’est pas excessif d’estimer qu’elle est l’expression déplacée de la fureur refoulée qu’il éprouvait à l’égard de la violence meurtrière et dévoratrice que lui avait fait subir son propre père, Tantale et de la culpabilité inconsciente ressentie à l’égard de la séduction active que lui avait infligé Poséidon, alors que lui-même, dans une position homosexuelle passive, apparaissait toujours comme un fils affectueux, et un échanson dévoué et fidèle. En se comportant en père tendre et protecteur à l’égard de son fils Chrysippe, Pelops montrait à la fois à Tantale et à Poséidon comment il aurait aimé être lui-même traité, en même temps que par cette réaction névrotique il évite de prendre conscience des mécanismes d’identification projective qui auraient pu le conduire à agir envers Chrysippe comme son père Tantale avait procédé avec lui, et comme Laïos le fit à sa place.
Quant à l’acte infanticide, chacun, qui a été père, sait que Laïos exposa Œdipe, pharmakoï maudit, les chevilles entravées, au sommet du mont Cithéron, ou bien dans une nacelle posée sur la mer.
La rencontre mortelle avec Œdipe chacun, qui a été fils, sait qu’elle eut lieu et comment elle se termina. Il est peut-être utile cependant de rappeler ici que c’est Laïos qui par sa superbe, son mépris, sa violence verbale et physique provoqua Œdipe et justifia dans le réel qu’il accomplit son destin. Cet ogre pédophile, ce meurtrier, cet impulsif qui dissimule derrière sa violence une homosexualité passive, ce Laïos que Freud ne pouvait ignorer, informé qu’il était, avec une extrême précision, de la mythologie grecque il n’en parle jamais si l’on en croit l’index de la Standard Edition. Cela peut déjà donner à penser, et raviver une curiosité qui s’exerce de plus en plus activement à l’égard de quelques aspects de sa vie et de celle de son propre père.
DE QUELQUES « CURIOSITÉS » DANS LA BIOGRAPHIE DE SIGMUND FREUD
Généalogie officielle de Sigmund Freud
Ce schéma mérite un certain nombre de commentaires. Il faut d’abord dire que le père de Freud, son frère Emmanuel et leurs familles vivaient pratiquement ensemble, et qu’ainsi, étaient réunis sous un même toit, à Freiberg trois générations dont les âges ne correspondaient pas, proposant donc des images ambiguës pour chacun des enfants. On constate en effet, que le père qui a l’âge de Nannie, la vieille servante, et fait figure de grand-père, dort avec sa femme Amélie ; il est tout-puissant en apparence, mais en fait, il s’agit d’un négociant malchanceux et d’un juif menacé par les campagnes antisémites de l’époque. La mère a l’âge de ses beaux-fils ; Nannie qui est pieuse et autoritaire sera jetée en prison pour vol, quand le jeune Freud avait deux ans et demi, et cela sur dénonciation de son oncle Philippe au moment de la naissance d’Anna ; elle est catholique et membre du groupe majoritaire mais elle est au service de juifs minoritaires. Philippe a l’âge de sa belle-mère et le jeune Sigmund vit un certain nombre de fantasmes qu’il retrouvera plus tard dans son autoanalyse concernant la naissance de ses jeunes frères et sœurs et les rapports entre Philippe et sa mère Amélie. John, son neveu se révèle beaucoup plus robuste que lui et le bat rudement devant Pauline qui est son premier amour. L’autoanalyse de Freud lui permit de prendre conscience progressivement, d’un intense sentiment d’agressivité camouflé pour son père et pour Philippe, de l’ambivalence de ses sentiments pour John qui entraînera par la suite les difficultés que l’on connaît sur le plan de ses relations amicales avec les hommes et enfin son attachement massif à Nannie, à Pauline et surtout à sa mère qui sont à la base de la découverte du complexe d’Œdipe.
Mais en fait les recherches publiées au long de ces dix dernières années ont interrogé cette iconographie officielle, construite essentiellement à partir de ce que Freud lui-même nous a dit de lui dans ses œuvres ou sa correspondance (soigneusement filtrée par les héritiers toutefois) et du travail monumental, dans le double sens de grandiose et de statue édifiée en hommage posthume d’Ernest Jones La vie et l’œuvre de Sigmund Freud[2]. Parmi les plus instructifs de ces travaux, je citerai Max Schur[3], La mort dans la vie de Freud, Didier Anzieu[4], Wladimir Granoff[5] Filiations, Marie Balmary[6] L’homme aux statues. Freud et la faute cachée du père qui fait preuve de nombreuses et brillantes intuitions, si sa thèse paraît par ailleurs quelque peu rigide et dogmatique.
À partir des données nouvelles qu’apportent ces auteurs et des recoupements que j’ai pu opérer je vous propose de considérer le tableau II intitulé « la mythographie de Sigi ». Il s’est sensiblement complexifié. Dans le cadre de ce travail je choisis de porter notre regard curieux sur quatre points problématiques choisis parmi beaucoup d’autres possibles :
– la date de naissance réelle de Sigmund Freud ;
– quelques aspects particuliers de la vie de Jakob Freud, son père ;
– la dissimulation de la deuxième épouse, Rebecca, de Jakob Freud ;
– la vie extrêmement douteuse de l’oncle Joseph ;
Ce parcours nous permettra :
1) de retrouver certains éléments significatifs entrevus à propos du mythe œdipien avec une analogie Laïos-Jakob Freud,
2) de nous interroger sur la fonction économique de diverses théorisations de Freud, en particulier l’abandon de la théorie de la séduction, le statut du fantasme, l’articulation du contre-transfert et du transfert.
Sur la date de naissance de Sigmund Freud
E. Jones écrit : « Sigmund Freud naquit le 6 mai 1856 à 18 h 30 à Freiberg en Moravie » premiers mots du tome I avec en bas de page la note suivante : « Quant en 1931 les habitants de Freiberg (aujourd’hui Eribor) apposèrent une plaque sur la maison natale de Freud, ils découvrirent que d’après le registre local, Freud était né le 6 mars. Il s’agit sans doute d’une erreur de copie dont il y aurait lieu d’accuser un fonctionnaire, aucune autre naissance n’a été enregistrée avant le mois d’octobre. Ainsi, en venant au monde, Freud fut la cause indirecte d’une de ces erreurs mentales qu’il devait quarante ans plus tard, devenu professeur, élucider ». Notons au passage la propre erreur mentale de Jones car Freud fut nommé professeur associé en 1902, après le voyage à Rome, à l’âge de quarante-six ans. Notons aussi que les ouvrages les plus récents consacrés à Sigmund Freud confirment tous – et singulièrement celui édité par Ernest et Lucie Freud, où la notice biographique est due à la plume d’Eissler : 6 mai.
W. Granoff rapporte le commentaire proposé par les époux Bemfeld dans leur article : « Freud’s early childhood » publié dans l’ouvrage collectif Freud as we knew him : Sigmund Freud, interrogé se serait fâché brusquement que l’on veuille le faire vieillir de deux mois, et aurait ajouté que sa mère lui avait indiqué sa date de naissance et que si quelqu’un pouvait la connaître avec exactitude c’était bien elle. Cet avis fut ratifié par le Comité qui fit graver ainsi la plaque commémorative. Le doute qui plane sur cette date de naissance est intéressant en ce que si Freud est effectivement né le 6 mars et non le 6 mai, sa mère Amalia se serait alors mariée enceinte de deux mois et le caractère séducteur de Jacob Freud, dont nous aurons à reparler, autoriserait un début de rapprochement Jacob-Laïos[7].
Sur Jacob Freud
Là aussi, se pose un problème de date de naissance. On sait que Jacob Freud naquit à Tysmanica en Galicie. Mais quand ? La date fut choisie postérieurement à l’événement et comme Jones le rapporte identifiée à celle de la naissance de Bismarck (01-04-1815), date finalement officiellement adoptée. Mais certains registres tchèques portent la trace d’une naissance en 1805, susceptible de se rapporter à Jacob Freud. Dans tous les cas de figure l’âge de Jacob Freud interroge :
– s’il est né en 1815 il se serait marié à vingt-six ans, pour la première fois, à cinquante ans pour la troisième avec une femme de vingt ans, lui aurait fait huit enfants dans la décennie suivante et se serait éteint à quatre-vingt-onze ans, plus âgé que son fils lors de sa propre mort ;
– s’il est né en 1805, il se serait marié à seize ans, ce qui n’était justifié ni économiquement ni religieusement (Granoff) et aurait eu son premier fils à dix-sept ans ;
– enfin, sa sœur Anna écrit dans l’ouvrage collectif déjà cité dans l’article « My brother Sigmund Freud » que leur père se serait marié à trente-six ans alors déjà grand-père, avec une femme ayant moins de la moitié de son âge.
Règne donc le flou le plus vague sur les dates et les nombres ce qui a pu contribuer au choix de Wilhelm Fliess comme étai transférentiel dans l’autoanalyse de Freud. Toutefois, dans tous les cas, nous avons affaire à un personnage à la vie sexuelle très active que ce soit dans sa prime jeunesse (hypothèse 1805) ou dans sa maturité avancée (hypothèse 1815) cela sans oublier qu’il eut une deuxième épouse (vide infra) et qu’il épousa vraisemblablement la première alors qu’elle était grosse de deux mois (vide supra). Quelle différence avec un fils marié à trente ans après quatre années de chastes fiançailles, époux fidèle et vertueux et qui dans une lettre à Fliess laisse entendre que son activité sexuelle s’est rapidement épuisée après la quarantaine (soit 1896 : naissance d’Anna, mort du père, et année qui suit la publication des Études sur l’Hystérie).
D’où l’intérêt que l’on peut apporter dans ce contexte à la sensibilité particulière de Freud pour le personnage et le mythe de Don Juan. On connaît son amour immodéré pour l’Opéra de Mozart, alors qu’il reconnaissait bien volontiers n’être pas mélomane « pour la musique je suis incapable d’en jouir » (dans les premières lignes de son article sur le Moïse de Michel Ange). En témoigne plus particulièrement ce qu’il écrivait à Marie Bonaparte sur le tard de sa vie, dans une lettre datée du 6 décembre 1936 : « Souvent en caressant Tolfi, je me surprends à fredonner une mélodie que je connais, bien que je ne sois pas du tout musicien, l’aria de Don Juan : un lien d’amitié nous unit tous deux ».
C’est dans ce contexte que l’attention se porte naturellement sur deux lettres à Fliess :
– la première en date du 16 avril 1896, où Sigmund Freud fait état de crises d’angoisses de mort, à la suite précisément de la mort du célèbre sculpteur de l’époque Tilgren qui venait d’achever une statue de Mozart commandée par la ville de Vienne et décéda six jours avant l’inauguration (à rapprocher de la crainte de Freud de ne jamais pouvoir, tel Moïse, atteindre la Terre Promise). Les mesures gravées sur la statue étaient extraites de la dernière scène où Don Juan meurt, tué par le Commandeur dont il a séduit la fille ;
– la seconde est datée du 23 mai 1897 : « Cher Wilhelm, je t’envoie ci-joint le “catalogue de toutes les merveilles”, etc. Le Conseil des Professeurs fait attendre sa décision. »
Il s’agit de la bibliographie des travaux de Freud mais les guillemets évoquent très clairement la phrase du valet Leporello s’adressant à l’épouse de Don Juan, pour lui présenter le carnet où sont inscrites les « mille et trois » conquêtes de son maître : « Madame, ce catalogue est celui des belles qu’aima mon maître ». Entre ces deux lettres, publiées in Naissance de la psychanalyse témoignant de l’intérêt de Freud pour Don Juan, décède le 23 octobre 1896, le père de Freud, Jacob. Dans l’année qui suit le thème de Don Juan semble quitter la pensée de Freud. Par contre il commence à désirer vraiment se rendre à Rome, ne le peut encore, puis publie l’Interprétation des Rêves en 1900 et visite enfin Rome en 1901. Don Juan va laisser sa place à Moïse.
Il convient de relever ici la remarquable intuition de Marie Balmary qui rapprochant les initiales des prénoms des enfants de Freud : Mathilde (comme M. Breuer), Martin (comme J.M. Charcot), Olivier (comme O. Cromwell), Ernest (comme E. Brücke), Sophie et Hanna écrit à la manière juive (toutes deux comme les Hammerschlag) obtient Moshe, soit Moïse en hébreu. Il ne s’agit pas ici simplement d’un jeu de mots, comme en témoignent :
– une citation de Freud dans l’Interprétation des Rêves parlant des prénoms de ses enfants : « je tenais à ce que leurs noms ne fussent pas choisis suivant la mode du jour, mais déterminés par le souvenir de personnes chères, leur nom fait des enfants des revenants, seul moyen d’atteindre à l’immortalité »[8].
– le fait que Freud lui-même usa du processus de l’anagramme pour décider que Massena, né le même jour que lui (avec un siècle… et peut-être deux mois, de différence) était juif par assimilation à Manasse le fils du Joseph de la Bible.
La statue de Moïse à Rome va donc remplacer la statue du commandeur. Ce n’est qu’après plusieurs voyages, en 1913, qu’il écrivit son essai, primitivement non signé et publié dans Imago en 1914. Nous le retrouverons en évoquant Rebecca. Relevons quand même tout de suite ce qu’il devait en écrire dans une lettre du 12 avril 1933 à Eduardo Weiss[9] : « Le Moïse italien m’a fait particulièrement plaisir. Mes rapports avec ce travail sont un peu comme ceux que l’on aurait avec l’enfant de l’amour. Pendant trois semaines de solitude, en septembre 1913, je suis resté debout tous les jours dans l’église, en face de la statue, l’étudiant, la mesurant, la dessinant, jusqu’à ce que s’éveille en moi cette compréhension que dans mon essai, je n’ai osé présenter que de façon anonyme. Ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai légitimé cet enfant non analytique ».
Passons au problème de Rebecca, l’épouse ni légitime ni analytique du père.
Sur Rebecca
Mon point de départ est le texte de Freud sur les erreurs[10] qui comporte lui-même une curieuse erreur de traduction, le texte, la nature des erreurs, et l’erreur de traduction, étant en relation avec le père et la différence des générations.
Relisons Freud : « Dans mon livre Die Traumdeutung (1900, 3e édition, 1919), je me suis rendu coupable d’une foule d’erreurs portant sur des faits historiques et autres, erreurs qui m’ont frappé et étonné lorsque j’ai relu le livre après sa publication. Un examen un peu approfondi n’a pas tardé à me montrer que ces erreurs ne tenaient nullement à mon ignorance, que c’étaient des erreurs de mémoire facilement explicables par l’analyse.
b) Page 135, je donne au père d’Hannibal le nom d’Hasdrubal. Cette erreur, qui m’a été particulièrement désagréable, ne m’a d’ailleurs que confirmé dans la conception que je me suis fait des erreurs de ce genre. Peu de lecteurs de mon livre étaient mieux au courant de l’histoire des Barkides que moi qui ai commis cette erreur et l’ai laissée passer dans trois épreuves. Le père d’Hannibal s’appelait Hamilcar Barkas ; quant à Hasdrubal c’était le nom du frère d’Hannibal, ainsi d’ailleurs que celui de son beau-frère et prédécesseur au commandement.
c) Pages 177 et 370, j’affirme que Zeus a émasculé et renversé du trône son père Kronos. J’ai par erreur fait avancer cette horreur d’une génération : la mythologie grecque l’attribue à Kronos à l’égard de son père Ouranos. Comment se fait-il que ma mémoire se soit trouvée en défaut sur ces points, alors que (et j’espère que mes lecteurs ne me démentiront pas) j’y retrouve habituellement sans difficulté les matériaux les plus éloignés et les moins usités ? Et comment se fait-il encore que, malgré trois corrections d’épreuves, ces erreurs m’aient échappé, comme si j’avais été frappé de cécité ?
Dans les trois exemples cités plus haut, il s’agit d’ailleurs du même sujet : les erreurs sont des produits d’idées refoulées se rapportant à mon père décédé.
L’erreur qui m’a fait dire Hasdrubal au lieu de Hamilcar, c’est-à-dire qui m’a fait mettre le nom du frère à la place de celui du père, se rattache à un ensemble d’idées où il s’agit de l’enthousiasme pour Hannibal que j’avais éprouvé étant encore jeune lycéen et du mécontentement que m’inspirait l’attitude de mon père à l’égard des « ennemis de notre peuple ». J’aurais pu laisser se dérouler les idées et raconter comment mon attitude à l’égard de mon père s’est modifiée à la suite d’un voyage en Angleterre, où j’ai fait la connaissance de mon demi-frère, le fils que mon père avait eu d’un premier mariage. Mon demi-frère a un fils qui me ressemble ; je pouvais donc, sans aucune invraisemblance, envisager les conséquences de l’éventualité où j’aurais été le fils, non de mon père, mais de mon frère. C’est à l’endroit même où j’ai interrompu mon analyse que ces fantaisies ont faussé mon texte, en me faisant mettre le nom du frère à la place de celui du père.
C’est encore sous l’influence de ce souvenir de mon frère que je pense avoir commis l’erreur consistant à faire avancer d’une génération l’horreur mythologique de l’Olympe grec. Des conseils que m’avait donnés mon frère, il en est un qui est resté très longtemps dans ma mémoire : « En ce qui concerne ta conduite dans la vie, me disait-il, il est une chose que tu ne dois pas oublier, tu appartiens, non à la deuxième, mais à la troisième génération, à partir de celle de notre père ». Notre père s’est d’ailleurs remarié plus tard pour la troisième fois alors que ses enfants du deuxième mariage étaient déjà assez avancés en âge. Je commets l’erreur c) à l’endroit précis de mon livre où je parle du respect que les enfants doivent à leurs parents.
« Notre père s’est d’ailleurs remarié plus tard pour la troisième fois » nous laisse perplexe. Granoff[11] a eu l’idée de consulter la traduction de Strachey : « our father had married again in a later life » et dans le texte original dont il donne la traduction suivante qu’il commente aussitôt :
« Une des admonitions de mon frère resta gravée longtemps dans ma mémoire. Il est une chose, me dit-il, que tu ne dois pas oublier pour ce qui est de ta conduite dans la vie. C’est qu’en réalité tu appartiens non pas à la seconde, mais à la troisième génération en rapport avec notre père. Notre père s’était remarié de nouveau tard dans la vie et par conséquent était bien plus âgé que ses enfants du second mariage ». « Jankélévitch fait deux erreurs, car d’une part il écrit : « Notre père s’étant remarié une troisième fois » et d’autre part il ajoute : « alors que ses enfants du deuxième mariage étaient déjà avancés en âge », ce qui est proprement incompréhensible ».
L’existence de Rebecca était à l’évidence inconnue de Jankélévitch, le traducteur en français, comme de Strachey et en tout cas non évoquée par le texte original de Freud.
Il est intéressant aussi de relever les erreurs non corrigées par Freud, dans son travail sur Léonard, par exemple : Léonard est en effet né d’un troisième mariage d’un père, qui remarié ultérieurement procréera encore avec fécondité. Freud se trompe sur le nombre des enfants, oubliant celui qui suit Léonard (la trace de Julius), se trompe sur l’âge de la mort du père de Léonard, comme il lui arrivera de se tromper sur celle de son propre père quand, peu après la mort de Sophie son « enfant du dimanche » à Hambourg à l’âge de vingt-six ans lors de la fameuse épidémie de grippe, il écrit à Jones qui vient de perdre son propre père (nous sommes en 1920) : « j’avais près de votre âge lorsque mourut mon père (quarante-trois ans) et cela me remua jusqu’au fond de moi-même ». Jones note qu’en « réalité nous avions tous deux quarante et un ans à la mort de nos père, mais Freud en avait quarante-trois lorsqu’il écrivit l’Interprétation des Rêves et cette erreur de mémoire est une preuve de plus de l’étroite interrelation qui existait dans son esprit entre ces deux éléments »[12].
Qu’en est-il alors de cette fameuse Rébecca ?
Une recherche conduite par Sajner[13] et citée par Max Schurr (pp. 37-39), permet d’établir les faits suivants à partir de la consultation systématique des registres des naissances, mariages, déplacements et décès :
– on ne connaît pas la date exacte de la mort de Sally Freud ;
– en 1852 figurent sur les registres de la population juive de Freiberg : Jacob Freud, âgé de trente-huit ans, sa femme Rebekka, âgée de trente-deux ans, les deux fils de Jacob, Emmanuel vingt et un ans marié à Maria dix-huit ans, et Philippe âgé de seize ans ;
– en 1854, le nom de Rebekka n’est plus mentionné. Elle ne pouvait être la même personne que Sally car alors elle aurait accouché d’Emmanuel à onze ans. Elle avait donc disparu par divorce, par décès, voire suicide.
Nous quittons maintenant le domaine des faits pour entrer dans celui des conjectures et des interrogations : qui a connu l’existence de ce mariage ? Comment a-t-il été dissous ? Amalia l’a-t-elle complètement ignoré ? Si oui quelles obscures raisons justifieraient le secret ? De toute façon Frieberg était une petite communauté fermée (moins de 5 000 habitants) ; la « légende familiale » devait s’inscrire dans une certaine « ambiance »[14]. Il est évident en tout cas que Jakob, Emmanuel, sa femme et Philippe étaient au courant. Quant à Sigmund Freud ? « Certainement pas consciemment » répond Schur.
Le mieux est de revenir au texte de Freud, et par exemple le récit d’un « rêve absurde » qu’il rapporte et commente dans l’Interprétation des Rêves[15]. « Voici un autre rêve absurde de père mort : je reçois une lettre du conseil municipal de ma ville natale concernant les frais d’une hospitalisation en 1851 nécessitée par une attaque. Cela me paraît très comique, car d’abord en 1851 je n’étais pas né et en second lieu, mon père, à qui cela pourrait se rapporter, est déjà mort.
Je vais le trouver dans la chambre à côté où il est couché et je lui raconte. A mon grand étonnement, il se rappelle qu’en 1851 il s’était un jour énivré et fut conduit au poste ou enfermé. C’était au temps où il travaillait pour la maison T… « tu as donc bu aussi ? » lui demandai-je. « Et tu t’es marié aussitôt après ? ». Je calcule que je suis, en effet, né en 1856, date qui me paraît suivre immédiatement l’autre.
« Dans le rêve absurde qui contient l’histoire de la lettre du conseil municipal, je calcule que je suis né en 1856, date qui me paraît suivre immédiatement l’autre. Tout cela revêt bel et bien la forme d’une conclusion logique. Mon père s’est marié bientôt après l’attaque, en 1851 ; je suis le fils aîné, né en 1856 ; donc cela est juste. Nous savons que cette conclusion est altérée par l’accomplissement d’un désir et que la pensée dominante du rêve est : quatre ou cinq ans, ce n’est rien, ça ne compte pas ».
Les associations et commentaires de Freud le conduisent à évoquer la figure de Breuer comme substitutive du père, puis celle de Meynert et le jour où il annonça ses fiançailles à son père sans avoir demandé préalablement son autorisation. Je cite deux extraits[16] : « L’absurdité la plus forte et la plus déroutante du rêve est dans ma façon de considérer l’année 1851 qui ne me paraît pas différente de 1856, comme si un intervalle de cinq années ne comptait pas. Mais c’est cela précisément que veulent exprimer les pensées du rêve ; quatre ou cinq ans c’est le temps pendant lequel j’ai été aidé par le confrère dont j’ai parlé plus haut, mais aussi le temps pendant lequel j’ai différé mon mariage et fait attendre ma fiancée, et, par un hasard que les pensées du rêve utilisent souvent, la durée du traitement que j’indique actuellement à ceux de mes malades avec qui je suis le plus en confiance. « Qu’est-ce que cinq ans ? » demandent les pensées du rêve. « Ça n’est rien pour moi, ça ne compte pas. J’ai le temps devant moi et j’arriverai bien à mes fins : il est bien arrivé d’autres choses que vous croyiez impossibles ». De plus le nombre 51 isolé, a encore un autre sens, celui d’une opposition. C’est pourquoi il intervient dans le rêve à plusieurs reprises. 51, c’est l’âge où l’homme semble le plus exposé, où j’ai vu mourir subitement des collègues, un, entre autres, qui, après avoir longtemps attendu, venait d’être nommé professeur quelques jours avant ».
« Ainsi par exemple, j’affirme que des impressions remontant à la deuxième, parfois même à la première année de la vie de l’individu laissent une trace ineffaçable dans la vie psychique de ceux qui seront plus tard des malades, et que ces impressions – quoique souvent déformées et exagérées par le souvenir – peuvent être la première et la plus profonde raison d’un symptôme hystérique. Des malades à qui je donne ces explications quand je dois le faire se moquent de moi, se déclarant prêts à rechercher des souvenirs datant du temps où ils n’étaient pas encore nés. Je m’attends à ce que la révélation du rôle inconnu jusqu’à présent, que joue, chez les malades femmes, le père dans les premières impulsions sexuelles, reçoive le même accueil (voir l’exposé de la p. 224). Et pourtant je suis profondément convaincu que les deux idées sont exactes et fondées. Elles sont confirmées par certains exemples où le père est mort alors que l’enfant était encore en bas âge, et où des événements survenus plus tard resteraient inexpliqués, si l’on ne pouvait admettre que l’enfant avait gardé de son père des souvenirs inconscients ».
Ces quelques citations peuvent nous laisser perplexes : annuler cinq années, évoquer son mariage faire référence à des « souvenirs datant du temps où ils n’étaient pas encore nés » (phrase soulignée par Freud), craindre le chiffre 51 (Fliess lui avait prédit que ce serait le terme de sa vie par l’addition des nombres 28 et 23 représentant les périodes féminine et masculine) ne tournons-nous pas autour d’un grand secret non consciemment su mais revenant comme le refoulé ? Il était dès lors intéressant de rechercher si le nom de Rebecca apparaissait dans l’œuvre de Freud : oui, à deux reprises et d’une manière bien significative :
1) d’abord dans la lettre 69 du 21 septembre 1897 où il fait part à Fliess de sa déception après l’abandon de l’une de ses hypothèses scientifiques. Il écrit ainsi (in Naissance de la psychanalyse) : « Je continue ma lettre par des variations sur les paroles d’Hamlet : “To be in readiness”. Garder sa sérénité, tout est là. J’aurais lieu de me sentir très mécontent. Une célébrité éternelle, la fortune assurée, l’indépendance totale, les voyages, la certitude d’éviter aux enfants tous les graves soucis qui ont accablé ma jeunesse, voilà quel était mon bel espoir. Tout dépendait de la réussite ou de l’échec de l’hystérie. Me voilà obligé de me tenir tranquille, de rester dans la médiocrité, de faire des économies, d’être harcelé par les soucis et alors une des histoires de mon anthologie me revient à l’esprit : “Rébecca, ôte ta robe, tu n’es plus fiancée !” ».
Cette histoire fait référence à la non-conclusion d’un heureux mariage alors en projet. Et quel est le succès auquel Freud renonce, en évoquant le nom de la deuxième femme de son père ? La première partie de la lettre nous l’indique p. 191 : « Il faut que je te confie tout de suite le grand secret qui au cours de ces derniers mois s’est lentement révélé, je ne crois plus à ma neurotica ». La neurotica c’est la thèse de la séduction, active ou passive, comme cause de la névrose. Et de donner des explications : les échecs dans les traitements, « la surprise de constater que dans chacun des cas il fallait accuser le père de perversion, y compris le mien » (ces quatre mots sont omis dans l’édition allemande et la traduction française, mais rétablis par Strachey), le fait qu’une telle généralisation des actes pervers commis envers des enfants semblait peu croyable ».
Ainsi le nom de Rebecca est-il évoqué dans la lettre même où Freud renonce à « épingler le Père », à rechercher la faute du père pervers. Après avoir ignoré Laïos, l’ogre pédophile, Freud ne pouvait que ne pas voir Jacob comme un séducteur et un transgresseur des lois sexuelles de son époque. Nous assistons là au passage de la théorie de la séduction (attentat sexuel commis par le père, un oncle, un frère des futures hystériques) à celles du fantasme né du désir refoulé de la patience. De même ce sont les désirs refoulés du fils envers la Mère qui le conduiront à se situer en position de rival et de meurtrier du père. Ainsi Freud approchait-il mais au prix de quel effort dans son économie privée, de la construction du complexe d’Œdipe. Autrement dit la nécessité pour Freud de maintenir refoulé un souvenir inconscient a-t-il contribué de manière décisive à la mise en forme de l’un des concepts majeurs, et le plus universellement connu, de la psychanalyse : le complexe d’Œdipe ? Certains indices permettent de le penser et en particulier les circonstances où apparaît pour la deuxième fois le nom de Rebecca dans son œuvre, la première étant le récit d’une déception scientifique et d’un échec personnel.
2) Il s’agit de la deuxième partie de son article portant sur « Quelques types de caractère dégagés par la psychanalyse » [17], partie qui porte justement et significativement comme titre « ceux qui échouent devant le succès » la première traitant des « exceptions » et la troisième des « criminels par sentiment de culpabilité ». Pour ce travail, Freud propose une étude psychanalytique de deux personnages, Lady Macbeth et Rebecca West tirée du drame d’Ibsen. Je suis parfaitement la critique que propose Marie Balmary de l’analyse de Freud : « C’est une femme ” libre et hardie ” qui joue chez le pasteur Jean Rosmer le rôle de gouvernante. La femme du pasteur, Félicie, maladive et sans enfant, est morte il y a un peu plus d’un an (et non il y a des années comme le dit Freud). Une amitié « purement intellectuelle et idéale » unit Jean Rosmer et Rebecca, du moins dans l’esprit du premier. Mais la médisance les atteint d’autant plus âprement que le pasteur est en train d’abandonner ses anciennes croyances. Le spectateur de ce drame, où le mal caché vient peu à peu au jour comme chez Sophocle, apprend qu’en fait Félicie ne s’est pas noyée par un coup de désespoir dû à sa stérilité mais par une machination infernale. Rebecca avait, par des allusions, des livres laissés en évidence, des paroles ambiguës, conduit Félicie à s’interroger sur la validité de cette union stérile, laissé soupçonner à la pauvre femme que son mari était en train d’abandonner la foi pour se rallier aux idées progressistes et que bientôt elle, Rebecca, devrait « nécessairement » quitter la maison – afin de dissimuler les suites d’un commerce illicite, laisse-t-elle croire à Félicie sans le dire clairement. Félicie s’est donc suicidée afin de ne pas barrer à l’homme aimé le chemin du bonheur.
Toute la pièce se situe après la mort de Félicie. Ce qui intéresse Freud, c’est le refus de Rebecca de devenir la seconde femme de Rosmer, comme celui-ci le lui propose avant que tout ne soit révélé, afin de faire taire les médisances. Rebecca aime Rosmer ; elle a tout fait pour l’avoir, jusqu’au crime. Et pourtant elle parle de se suicider comme Félicie lorsque Rosmer demande pourquoi elle refuse sa proposition de mariage. Elle finira par tout avouer lorsqu’un troisième personnage – le frère de Félicie – viendra lui apprendre quelle est, elle, Rebecca, non la fille adoptive mais la fille adultérine de l’homme qui l’a élevée, le Docteur West.
Freud donne alors là une explication psychanalytique : Rebecca a sûrement été la maîtresse de son père adoptif mais elle ignorait qu’il fût son vrai père. C’est pour cela qu’elle « craque » ensuite et avoue tout à propos du meurtre de Félicie. Freud nous dit là qu’elle ne livre un secret (le meurtre de la femme) que pour en taire un autre (l’inceste avec le père). Le drame d’Ibsen abonde en phrases et en situations ambiguës et c’est de là qu’il tire sa force. Mais nous nous étonnons, après avoir relu la pièce, du ton définitif de Freud à propos de Rebecca : « Nous comprenons, certes, maintenant, que ce passé lui apparaisse le plus grand obstacle au mariage, le plus grand crime ». Puis Freud continue : « C’est après avoir appris qu’elle a été la maîtresse de son propre père qu’elle devient la proie de son sentiment de culpabilité… Elle fait à Rosmer (…) la confession où elle s’avoue meurtrière ; elle renonce définitivement au bonheur vers lequel elle s’était frayé la voie par son crime même, et se prépare au départ ». Ce que Freud nous raconte ici, c’est la fin de l’acte. Mais nullement la fin du drame. La chose est curieuse. Il admirait tant le déroulement implacable de cette pièce : pourquoi ne rien dire alors de son dénouement ? Nous avions déjà remarqué à propos de Lady Macbeth que Freud ne mentionne pas son suicide final. Or, ici encore, c’est un suicide – un double suicide – qui est passé sous silence. Voici rapidement la fin de l’histoire. Une dernière entrevue a lieu entre Rebecca et Rosmer, au moment où elle s’apprête à quitter Rosmersholm. Lui, voudrait bien la retenir, mais comment pourra-t-il jamais la croire à présent, après tous ces mensonges ? Dans un moment de trouble, d’égarement, il laisse échapper quelques mots qui montrent à Rebecca la voie : elle ne peut plus être crue de lui que par un geste, le suicide, preuve qu’elle l’aime autant que Félicie l’a aimé. Rebecca accepte ; Rosmer, voyant qu’il ne peut plus désormais effacer ce qu’il a dit, choisit de mourir lui aussi ; enlacés, ils se jetteront dans le bief du moulin. C’est donc sur un souhait à peine formulé de Rosmer que Rebecca se tue (comme c’était peut-être, pensons-nous, sur son souhait, moins formulé encore, qu’elle avait tué Félicie. Le suicide à deux ne parle-t-il pas d’un crime à deux ?).
Or, Freud n’évoque rien de tout cela. En revanche, il affirme un acte criminel dans le passé de Rebecca, son inceste avec son père, qui n’est pas signalé par des traces indiscutables dans le texte. Évidemment l’explication de Freud est conforme à la théorie du complexe d’Œdipe. Le domaine de Rosmersholm serait pour le personnage de Rebecca le lieu de la répétition : « Tout ce qui lui est arrivé à Rosmersholm, son amour pour Rosmer et son hostilité contre sa femme, étaient déjà un effet du complexe d’Œdipe, une reproduction forcée de ses rapports à sa mère et au docteur West[18] ».
N’est-il pas curieux que, lorsqu’il s’agit de personnages imaginaires, Freud affirme avec vigueur que l’inceste a eu lieu réellement, et donc que le père a bel et bien été le séducteur de sa fille, alors que, depuis 1897, il affirme au contraire être revenu de cette erreur ? Il a « renoncé » à la théorie de la séduction pour les personnes vivantes ; elle se réengouffre dans son écriture pour les personnages imaginaires ».
Je propose pour mieux comprendre Rebecca que nous revenions maintenant au travail de Freud sur Le Moïse de Michel-Ange « cet enfant de l’amour… non analytique ». Il s’agit d’une longue étude très documentée et très savante bien qu’introduite par les mots : « je commence par le déclarer : je ne suis pas un vrai connaisseur d’art, mais un simple amateur ». Freud s’efforce de démontrer que ce Moïse n’est pas la représentation de la colère provoquée par la trahison de son peuple alors qu’il était allé chercher les Tables de la loi, dans sa fureur prêt à s’élancer pour châtier mais : « un autre Moïse, supérieur au Moïse de l’histoire ou de la tradition. Il a remanié le thème des Tables de la loi fracassées, il ne permet pas à la colère de Moïse de les briser, mais la menace qu’elles puissent être brisées, apaise cette colère ou tout au moins la retient avant d’agir. Par là, il a introduit dans la figure de Moïse quelque chose de neuf, de sur-humain, et la puissante masse ainsi que la musculature exubérante de force du personnage ne sont qu’un moyen d’expression tout matériel servant à rendre l’exploit psychique le plus formidable dont un homme soit capable : vaincre sa propre passion au nom d’une mission à laquelle il s’est voué ».
Parcourant ce travail nous apprenons bien des choses et pouvons en inférer de nouvelles :
– cette statue est élevée sur la tombe du Pape Jules II (comme Julius fut le deuxième enfant, décédé, de la famille Freud) ;
– cette statue devait faire partie d’un ensemble de six dont seulement deux ont été exécutées, Lea et Rachel, soit Vita activa et Vita contemplativa. Arrêtons-nous un moment sur ce couple biblique, deux sœurs qui ont été mariées successivement au même homme, et rapportons-nous au tableau III.
Isaac fils d’Abraham prit pour femme Rébecca. Il en eut. deux fils Esaü et Jacob ou Israël (« Deux nations sont dans ton sein, deux peuples se détacheront de tes entrailles, l’un sera plus fort que l’autre et le grand servira le petit » dit le Seigneur à Rebecca (Genèse 25). Esaü vend son droit d’aînesse à Jacob pour une brouet de lentilles, lequel peut ainsi avec l’aide de sa mère Rebecca dont il est le préféré usurper la bénédiction promise à Esaü l’aîné, lui préféré du père. Esaü veut tuer Jacob, qu’Isaac et Rebecca font partir auprès de Laban, frère de Rebecca. En chemin il fait le fameux songe de l’échelle dressée de la terre au ciel et sur laquelle montent et descendent les anges de Dieu. Et le Seigneur lui donne sa bénédiction à lui Jacob, fils d’Isaac, fils d’Abraham et à toute sa descendance. Jacob arrive chez Laban, rencontre d’abord Rachel qui « était belle à voir et à regarder » et l’aime aussitôt. Il se fait reconnaître, est accueilli et Rachel lui est promise en mariage contre sept années de travail « Jacob servit sept ans pour Rachel, et ils lui parurent quelques jours tant il l’aimait » (Genèse 29). Le soir de la noce, Laban glisse Léa, sa fille aînée, donc sœur de Rachel, à sa place dans le lit de Jacob. A sa surprise et à son courroux, Laban répond qu’avec sept ans de travail supplémentaire Jacob aurait aussi Rachel. Ce qui fut fait. Voyant que Jacob n’aime pas Léa, le Seigneur la rend féconde et lui donne successivement Ruben, Siméon, Levi, Juda alors que Rachel est aimée mais demeure stérile. Enfin Dieu exauce Rachel et lui donne un fils Joseph, puis un second Benjamin. Jacob s’enrichit, est contraint de fuir la terre de Laban puis conclut une nouvelle alliance avec lui, et s’apprête à rencontrer son frère Esaü. En chemin il lutte avec Dieu, ayant pris figure humaine, mais n’est pas vaincu, simplement blessé à la jambe (lui aussi !). Il reconnaît Dieu et obtient sa bénédiction. Il se réconcilie avec Esaü. Reste le personnage de Joseph. Il était le préféré de Jacob car il l’avait eu dans sa vieillesse, et donc détesté par ses frères. Cette haine s’attise quand Joseph fait le récit du songe des gerbes qui se prosternent devant la sienne (ses frères) ou du soleil, de la lune et des onze étoiles (toute sa famille) qui s’inclinent devant lui. Ses frères décident de lui donner la mort « voici venir l’homme aux songes. C’est le moment ! Allez ! Tuons-le et jetons-le dans des fosses… nous verrons ce qu’il advient de ses songes » (Genèse 37). Mais Ruben parvient à sauver Joseph et le vend aux Ismaélites. Ainsi Joseph arrive chez Potiphar son maître égyptien qu’il doit servir. Il est beau à voir. Il refuse les offres et les tentatives de séduction de la femme de son maître qui, dans son dépit, l’accuse de viol. Joseph, jeté en prison, interprète avec exactitude les rêves de deux prisonniers, le grand échanson qui retrouvera son rang, le grand panetier qui est promis à la mort. Les interprétations de Joseph restées fameuses il est tout naturellement appelé auprès du pharaon qui était embarrassé du songe des sept vaches grasses et des sept vaches malingres, et de celui de sept épis gonflés et appétissants et des sept épis durcis, gelés et brûlés, que personne ne savait lui expliquer. On sait ce qu’il en fut de la prophétie de sept années d’abondance qui précéderaient sept années de famine et de la nécessité de profiter des premières pour emplir les greniers et constituer des réserves. Enchanté de ces propositions pharaon nomme Joseph ministre et lui demande de mettre ses suggestions en pratique. Ce qui fut appliqué pour le plus grand bienfait de l’Égypte.
Deux fils naquirent à Joseph, Manassé et Ephraïm en début de la période de famine. Tout le monde vint alors en Égypte pour acheter du grain. Ainsi firent les frères de Joseph réalisant son rêve prémonitoire de la prosternation des gerbes. Plus tard ils revinrent avec le plus jeune Benjamin qui n’était pas du premier voyage, et finalement Joseph s’étant fait reconnaître, ce fut aussi le vieux Jacob qui prit le chemin de l’exil pour venir s’installer en Égypte auprès de son fils retrouvé.
En 1938, Freud s’exilait à Londres… « Je me compare quelquefois au vieux Jacob qui fut emmené en Égypte par ses enfants alors qu’il était très âgé », lettre à Ernst Freud du 12 mai 1938.
Que pouvons-nous comprendre de l’utilisation, consciente ou pas, faite par Freud de ces données, à l’évidence connues de lui, comme il nous l’indique lui-même dans Ma vie et la psychanalyse : « Très jeune alors que je venais d’apprendre ce qu’est l’art de lire, je me plongeai dans l’histoire biblique. Comme je le reconnus bien plus tard cela n’a cessé d’orienter mon intérêt » ? Six thèmes paraissent se dégager : le télescopage des générations, la rivalité fraternelle, l’attachement privilégié d’une mère à son fils, l’élection de Jacob, l’opposition des deux femmes d’un même époux, la place particulière de Joseph l’oniromancien :
– L’entremêlement des générations était déjà sensible dans la famille de Freud ; pour ce que nous venons d’exposer Jacob a pour mère Rebecca et pour fils Joseph l’interprète des rêves. Le jeune Sigismund, qui devait plus tard découvrir la clef des songes, pouvait très bien en fonction du principe d’intemporalité de l’inconscient retrouver dans ses prénoms familiers pour lui à la fois dans son environnement et ses lectures bibliques ses propres images archaïques ;
– La rivalité fraternelle est manifeste dans le texte, celle de Jacob et d’Esaü, plus tard de Joseph et de ses frères. On peut la rapprocher de celle de S. Freud par rapport à son frère Julius – et dont le décès à l’âge de dix-huit mois devait provoquer chez lui une intense culpabilité – et à son neveu John, rivalité qui devait colorer difficilement ses relations avec tous les hommes, collègues, disciples et l’engager dans la voie d’identifications héroïques ;
– L’attachement particulier de Rebecca à Jacob évoque celui de sa mère Amélia pour le jeune Sigmund, comme il devait l’écrire plus tard dans Souvenir d’enfance dans « Fiction et vérité » de Goethe. « Quand on a été sans contre-dit l’enfant préféré de sa mère on garde pour la vie ce sentiment conquérant, cette assurance du succès qui dans bien des cas l’assure effectivement » ; le couple Rebecca-Jacob, conjugal dans la vie de Freud, est incestueux dans le texte biblique ; c’est précisément un attachement de cette nature que Freud découvrira dans son auto-analyse et qu’il universalisera par la mise à jour et dans la tragédie grecque et dans la vie de chacun du complexe d’Œdipe ;
– L’élection de Jacob – n’oublions pas que c’était aussi le prénom du père de Freud – qui a vu Dieu en face et a gardé la vie sauve même s’il fut blessé à la jambe dans ce combat, l’élection de Jacob comme porteur de la descendance d’Israël en laquelle Freud, en dehors de tout esprit religieux se reconnaîtra toujours : « mes parents étaient juifs, moi-même suis demeuré juif » écrit-il dès les premières lignes de Ma vie et la psychanalyse et « je suis un vieux juif » seront ses premiers mots en arrivant à Londres, exilé ;
– L’opposition des deux épouses d’un même mari (le père de Freud fit aussi, officiellement, deux mariages) : Jacob est marié à deux femmes, Lea active et prolifique et Rachel quasi stérile et contemplative, comme Marthe et Marie dans le Nouveau Testament, comme Martha et Minna Bernays dans la propre vie de Freud ;
– Enfin la destinée singulière de Joseph l’interprète des songes subissant la haine et les tentatives d’homicide de ses frères, de séduction de la femme de son maître Potiphar, élevé ensuite aux plus hautes fonctions en Égypte où au crépuscule de sa vie son propre père le rejoindra pour le bénir.
Je peux maintenant revenir à Moïse et Don Juan : Moïse face à son peuple assemblé autour du veau d’or, le commandeur face à Don Juan l’impie sont deux messagers divins affrontant l’Infidèle. Freud est devant le Moïse de Michel Ange comme Leporello devant la statue du Commandeur : « car jamais aucune sculpture ne m’a fait une impression plus puissante. Combien de fois n’ai-je grimpé l’escalier raide qui mène du disgracieux Corso Cavour à la place solitaire où se trouve l’église délaissée ! Toujours j’ai essayé de tenir bon sous le regard courroucé et méprisant du héros. Mais parfois je me suis alors prudemment glissé hors la pénombre de la nef comme si j’appartenais moi-même à la racaille sur laquelle est dirigé ce regard, racaille incapable de fidélité à ses convictions, et qui ne sait ni attendre ni croire, mais pousse des cris d’allégresse dès que l’idole illusoire lui est rendue »[19].
En 1934 encore il écrira à Arnold Zweig dans une lettre datée du 16 décembre : « l’homme (Moïse) et ce que je voulais faire de lui me poursuit continuellement ».
On comprend dès lors qu’il n’ait pu aller à Rome avant d’avoir publié L’Interprétation des Rêves et s’être ainsi identifié à Joseph l’oniromancien. Cela pouvait être d’autant plus difficile qu’il avait dans sa réalité un véritable et douteux Joseph, son oncle.
Sur l’oncle Joseph
Voici ce qu’en écrit Freud : « Je n’ai eu qu’un oncle, l’oncle Joseph. Il y a à son sujet une triste histoire. Il s’était laissé entraîner, il y a quelque trente ans, dans un but de lucre à un acte que la loi sanctionne durement et fut alors puni. Mon père dont le chagrin rendit en peu de jours les cheveux gris avait coutume de dire que l’oncle Joseph n’avait jamais été un mauvais homme, mais une tête faible, c’était son expression »[20].
Qu’évoque pour lui le nom de Joseph ?
– Le Joseph de la Bible ;
– Joseph Breuer ;
– Le Docteur Joseph Pur médecin de la famille Freud à Freiberg, borgne et secourable qui lui donna des soins un peu après la mort de Julius, alors âgé de six mois (avec donc des sentiments de culpabilité durable pour le jeune Freud ambivalent devant ce rival) au moment des jeux avec sa cousine Pauline pour qui il éprouve des désirs incestueux et son cousin John qu’il veut sans cesse surpasser (relation qui fut « modélisante » pour celles de l’âge adulte avec les hommes). Ainsi qu’il le raconte lui-même dans L’Interprétation des Rêves à propos du fragment autobiographique de la « prairie aux fleurs jaunes » et dans l’Introduction à la psychanalyse, le jeune Sigmund fit une lourde chute du haut d’un escabeau où il s’était hissé pour obtenir quelques friandises. « J’aurais pu y laisser toutes mes dents », précise-t-il ainsi que l’absence totale de souvenir de l’incident, bien qu’il y ait eu hémorragie, pose d’agraphes et qu’il en ait gardé une cicatrice. C’est sa mère qui lui rappellera plus tard l’épisode avant que le cancer ne vienne le frapper là ;
– Joseph Paneth « mon ami Joseph », son condisciple cité dans L’Interprétation des Rêves et à qui il succéda à l’Institut de Physiologie d’Ernest Brucke ;
– Joseph Bonaparte dont il parle longuement dans une lettre à Thomas Mann le 24 novembre 1936 ; « … n’existe-t-il pas dans l’histoire un homme pour qui la vie de Joseph a pu être un modèle mythique, de sorte que nous puissions deviner le fantasme de Joseph comme étant, derrière son portrait biographique complexe, le moteur démoniaque et secret. Je pense que Napoléon Ier est cet homme (…) Son frère aîné s’appelait Joseph, et ce détail (…) marqua pour lui un destin. Dans toutes les familles corses, le droit d’aînesse est respecté avec une crainte sacrée (…). Suivant cette tradition corse, une relation humaine normale prend un caractère exacerbé. Le frère aîné est le rival naturel, le cadet éprouve à son égard une hostilité élémentaire dont on ne peut toucher le fond, et à laquelle, dans les années à venir, les termes de désir de mort et d’intention meurtrière pourront convenir. Éliminer Joseph, prendre sa place, devenir lui-même Joseph ont dû être chez Napoléon enfant le sentiment moteur le plus fort (…) ces motions infantiles excessives tendent à se retourner en leur contraire. Le rival haï devient un être aimé. Il en fut ainsi pour Napoléon. Nous en inférons qu’il a tout d’abord violemment détesté Joseph mais nous apprenons que, plus tard, il l’a aimé plus qu’aucun être au monde et qu’il n’a presque jamais pu reprocher quoi que ce soit à cet homme sans valeur et peu sûr. La haine primitive avait donc été surcompensée, mais l’ancienne agressivité jadis libérée n’attendait que d’être déplacée sur d’autres objets. Des centaines de milliers d’individus indifférents expieront le fait que le petit homme féroce a épongé son premier ennemi » ;
– enfin son oncle Joseph dont Jones écrit simplement que « ses démêlés avec la justice firent blanchir prématurément les cheveux du père de Sigmund » ajoutant en note « les frasques du jeune homme ne lui valurent que des amendes puisque nulle trace de condamnation ne se retrouve dans les archives de la police »[21].
La vérité est toute différente ainsi que nous le rappelle A. de Mijolla[22]. Une certaine Madame Renée Glichhom, non psychanalyste, va rétablir la réalité des faits, cela il y a près de quinze ans. On n’en parle guère dans nos milieux psychanalytiques comme si la curiosité vis-à-vis de la mythographie freudienne avait un caractère scélérat, et en tout cas interdit. En fait d’après les documents qu’elle a retrouvés et qu’elle cite il y eut instruction et procès de juin 1865 à février 1866 et condamnation à dix ans de travaux forcés, avec toutefois libération anticipée au bout de quatre années. Les archives judiciaires ayant disparu, c’est sur la lecture des journaux et périodiques de l’époque qu’a reposé cette recherche.
L’accusation est le trafic de faux roubles, avec des implications diplomatiques, le réseau de faux monayeurs s’étendait à toute l’Europe (Suisse, Angleterre dont Manchester, France, Pologne, Allemagne et Russie). Les faits, appuyés sur des documents ne paraissent pas réfutables. A partir de là, la rumeur et les insinuations, qui ont une réalité psychique, circulent. Deux nous intéressent :
– la ville de Manchester où demeurent Emmanuel et Philip, les deux frères de Sigmund Freud ;
– le fait que Jacob Freud, ruiné à Freiberg ait pu subvenir aux besoins de la famille, nombreuse, sans exercer aucun commerce ni acquitté le moindre impôt, pendant de longues années à Vienne. A partir de là, on peut associer,
rêver,
noter, que le rêve
de l’oncle est cité onze fois dans L’Interprétation des Rêves, soit en second rang juste après celui de l’injection faite à Irma.
Ce travail n’a pas l’ambition d’aboutir à des conclusions mais d’ouvrir un champ d’hypothèses. Je relève simplement quelques-unes des questions qu’il pose :
– celle du secret entourant tout ce qui s’écarte de l’hagiographie officielle du Père de la Psychanalyse et de l’absence totale de curiosité analytique par rapport à cela. Cela ne fut ni l’attitude d’Œdipe, ni celle de Freud ;
– les variations de la théorie de la séduction abandonnée au moment de la mort du père, enfouie mais qui revient dans les écrits ultérieurs[23];
– la précession du contre-Œdipe sur l’Œdipe dans l’inconscient universel. Freud l’écrit à propos de l’œuvre d’art, toujours dans son Moïse : « il faut que soit reproduit en nous l’état de passion, d’émotion psychique qui a provoqué chez l’artiste l’élan créateur… l’œuvre elle-même devra être susceptible d’une analyse si cette œuvre est l’expression effective sur nous des intentions et des émois de l’artiste ». Que n’a-t-il songé à Thésée, auprès de qui Œdipe trouvera au moment de sa mort son dernier secours, mais qui avait, lui, fait mettre à mort son fils Hippolyte accusé de vouloir lui ravir son pouvoir (par Aricie interposée) et sa femme (Phèdre) ? De cette précession il faut tenir compte dans la cure, l’éducation, les rapports sociaux ;
– enfin, plus généralement la reconnaissance de ce qu’aucune théorie n’échappe à sa fonction de défense sublimatoire dans l’économie psychique du théoricien, la théorie analytique pas davantage et ce travail bien entendu non plus.
Le fantôme de Freud veille sur nous. Enfoui dans sa tombe londonienne, en pays d’exil comme le vieux Jacob de la Bible, il étend son ombre immense sur tous les psychanalystes et contre-psychanalystes de cette planète. Il est le Commandeur dont nous redoutons, dans notre surmoi psychanalytique qu’il ne vienne châtier ceux qui ont commis l’inceste et le parricide, nous les psychanalystes qui avons rêvé de séduire la seule passion qui l’ait habité, son œuvre psychanalytique, et qui dans notre révérence excessive à son égard marquons notre incapacité à effectuer un travail de deuil, dont l’absence signe un désir porteur de la mort de son fondateur.
Séducteurs éternellement déçus par notre incapacité à remodeler la statuaire qu’il nous a léguée, malgré l’usure du temps et le jaillissement des sciences humaines, parricides impotents dans le florilège des hommages que nous lui adressons et des cécités que nous nous imposons, nous sommes désemparés.
Notre environnement conceptuel n’est plus celui de Freud ; la clinique contemporaine n’est plus celle de Freud ; les valeurs culturelles ne sont plus celles de Freud. Et pourtant nous sommes asservis à cet homme de génie, et au génie de cet homme. Inhibés dans notre capacité de penser autrement, nous nous accrochons aux virgules, aux variations sémantiques des traductions, et, alors qu’il a été notre guide dans l’interprétation des rêves, nous nous interdisons de rêver, et gâchons notre vie de psychanalystes dans des exégèses qu’elles soient savantes, désopilantes ou simplement lassantes.
Et si nous osions défier la statue du commandeur et si nous nous autorisons à penser librement – librement, je veux dire consciemment, librement — et si nous refusions de souscrire au mythe patiemment, scrupuleusement, filialement édifié par ses premiers disciples, ne redeviendrions-nous pas vraiment psychanalystes ? Quarante ans après sa mort, près d’un siècle après ses premiers écrits le moment de la curiosité n’est-il pas venu ? Si nous ne nous libérons pas de la chape lourde d’electrum, d’or et d’argent mêlé, qui couvre nos épaules comme les statues des pharaons, pouvons-nous entendre la parole de patients qui sont nés plus d’un siècle après sa naissance ?
La fidélité, c’est la vérité. La fidélité c’est l’exigence ; la fidélité c’est le contraire du mythe ; la fidélité c’est l’effort dans une illusion lucide de la recherche de la vérité d’aujourd’hui. La fidélité c’est aussi la passion du doute, et l’affirmation de l’incertitude. Ce monde change, les valeurs structurantes ou aliénantes évoluent, la vie des pulsions est l’objet à la fois d’un culte morbide, et d’une répression chloroformée, les formes d’adaptation du moi à la réalité psychique et à la réalité externe sont en même temps pris en charge par une pseudo-organisation de la société, et renvoyées à leur absolue solitude dans des villes de béton et des mentalités grégaires.
Nos patients nous interrogent. Notre vie personnelle nous interpelle. Nos institutions psychanalytiques nous étonnent. Que se lèvent le vent et la musique d’un nouveau monde, où la curiosité, pas seulement perverse, pas uniquement épistémophilique, nous appelle vers de nouvelles frontières.
N.B. : Ce travail a été rédigé bien avant l’ouverture, récente et partielle, des archives Freud. J’ai choisi de vous le présenter tel quel, dans le contexte historique de l’époque.
Notes
[1] S. Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne, Paris, Payot, 1967, p. 234.
[2] E. Jones, La vie et l’œuvre de Sigmund Freud, Paris, P.U.F., tome I, 1958, tome II, 1961, tome III, 1969.
[3] M. Schur, La mort dans la vie de Freud, Paris, Gallimard, 1975.
[4] D. Anzieu, L’auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse, Paris, P.U.F., 1975.
[5] W. Grassoff, Filiations, Paris, Éd. de Minuit, 1975.
[6] M. Balmary, L’homme aux statues, Freud et la faute cachée du père, Paris, Grasset, 1979.
[7] Au moment de la correction des épreuves de cet article, le doute ne subsiste plus pour moi, grâce notamment à D. Anzieu et A. de Mijolla. Freud est bien né le 6 mai.
[8] Souligné par moi.
[9] S. Freud, Correspondance, Paris, Gallimard, p. 452.
[10] S. Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne, op. cit., pp. 233 et suivantes.
[11] W. Granoff, Filiations, op. cit., p. 318.
[12] E. Jones, La vie et l’œuvre de S. Freud, op. cit., tome III, p. 22.
[13] J. Sajner, in « Sigmund Freud Beziehungen zu seinem Geburtsort Freiberg und zu Häbren », Clio Medica, 1968, 3, 167-180.
[14] M. Schur, La mort…, op. cit., p. 39.
[15] S. Freud, L’interprétation…, op. cit., pp. 375 et 382.
[16] S. Freud, L’interprétation…, op. cit., pp. 373 et 384.
[17] S. Freud, Quelques types de caractères dégagés par la psychanalyse, Imago, 1915.
[18] Cf. S. Freud, Essais de psychanalyse appliquée, Paris, Gallimard, 1971, 286 pages.
[19] S. Freud, Essais de psychanalyse appliquée, « Le Moïse de Michel-Ange », Paris, Gallimard, 1971, 256 pages.
[20] S. Freud, Introduction à la psychanalyse, Payot, chap. XIII.
[21] E. Jones, La vie et l’œuvre…, op. cit., tome I, p. 4.
[22] A. de Mijolla, « Mein Onkel Josef à la une ! », Études freudiennes, n° 15-16, Denoël, 1979.
[23] Cf. en particulier C. Chiland, « Le statut du fantasme chez Freud », Rev. Fr. de Psychanalyse, mars-juin 1971, tome XXXV, 2-3, pp. 203-216.
Le psychanalyste et son patient
En guise d’introduction : « Son »
Quelle est la relation du psychanalyste et de « son » patient ? Ainsi présentée, elle apparaît comme une perversion, une aliénation du sujet, soit l’envers absolu de ce à quoi s’efforce le travail analytique. La psychanalyse est la pulsion de la liberté et de la curiosité, pour autant que chacun puisse les accepter, dans les complexes et douloureux achoppements d’un trajet intime, sur la crête d’abîmes qui ont pour nom l’angoisse, l’illusion, la folie, la mort, l’espoir, la haine, la gratitude, l’amour. Le psychanalyste est là, garant d’un certain invariant, au sens mathématique, et d’une présence indéfectible même dans son habituel silence, scandé par des mots, échappés ou échafaudés, qui seront toujours ressentis par celui ou celle à qui ils sont illusoirement adressés comme des interprétations, même s’ils n’en sont pas stricto sensu.
Mais, le contre-transfert est un « contre » au sens où on l’emploie dans les jeux de ballon ou d’intelligence. Contre quoi ?
– contre le travail analytique personnel du praticien ;
– contre le transfert résiduel de sa propre analyse ;
– contre la psychanalyse qui fonde cependant son identité ;
– contre le transfert de ses patients.
En même temps qu’il est un contre, un moins, le contre-transfert est un pour, un plus, et en lui s’allient parfois douloureusement, parfois délicieusement, l’instinct de vie qui lie les affects, les pensées, les souvenirs, les rêves et l’instinct de mort, sans cesse à l’œuvre pour désunir, cataboliser et atomiser la pensée qui est notre seule vie sur cet éphémère parcours terrestre.
*
Voyons cela de plus près :
Le contre-transfert contre le travail psychanalytique personnel du psychanalyste, soit son auto-analyse.
Il est de bon ton d’affirmer que la fréquentation pluriquotidienne des patients fertilise l’auto-analyse du psychanalyste. Cela n’est sans doute pas faux, mais aussi demeure incomplet ou incertain. Nos patients, dans leurs paroles et leurs silences nous offrent en partage leurs émois, leurs souffrances, leurs espérances. En cela, ils réactivent en nous les points aveugles de notre propre analyse. Je ne tiens pas pour assuré qu’ils fassent ainsi systématiquement progresser notre propre travail auto-analytique. Il ne serait même pas paradoxal de soutenir que quand leurs errances entrent en collision avec nos propres scotomes analytiques, loin de les éclairer, elles renforcent nos défenses d’aveugles qui tiennent à leur cécité et cela d’autant plus qu’elle est menacée. Défenses, défenses chéries, que de rationalisations ont été commises pour vous protéger à l’abri d’un protocole dont Freud le premier eut l’honnêteté de reconnaître qu’il avait – et a toujours – pour fonction essentielle de mettre à l’abri « entre parenthèses » l’analyste. Là, gîte une réalité éventuellement perverse, occasionnellement thérapeutique. Encore convient-il de le savoir et de le dire. Le contre-transfert fonctionne aussi comme système pare-excitation contre les émotions parfois insupportables que les patients nous communiquent.
Et qu’en est-il, dans ce même registre, de notre désir d’accompagner, d’aider, de guérir, de traquer, de contempler – ces vocables évoquant les diverses sensibilités du mouvement psychanalytique contemporain – la souffrance ou l’espérance de ceux qui ont un jour, à une certaine heure, composé notre numéro de téléphone pour nous rencontrer une première fois et entrer ainsi dans la grande aventure voyageuse de leur vie ? Est-il excessif d’avancer, qu’au-delà des gratifications narcissiques et des bénéfices secondaires -pas toujours secondaires parce qu’ils nous font vivre le plus naturellement du monde, chaque jour -, cette démarche conforte une défense plus intime, secrète qui vise à nous protéger de nous, à ne pas entrouvrir au cœur de nous la gangue du diamant infracassable, le noyau de nuit que nous protégeons frileusement, de peur d’y découvrir fèces, immondices, détritus et autres horreurs d’une intimité familière mais étrange, déniée et refusée mais qui ne cesse de nous habiter ?
Il y a sûrement plus d’aisance à soigner les autres qu’à se soigner, à plonger son regard dans les abysses d’autrui plutôt que dans les siennes propres, à regarder et écouter ailleurs et autrui plutôt qu’ici et maintenant et en nous.
Le contre-transfert contre le transfert résiduel de notre propre analyse, jamais terminée bien sûr. Mais, nous voilà institués analystes, bien calés dans notre fauteuil, le même bien souvent que celui occupé par le personnage mystérieusement familier que nous avons fréquenté plusieurs fois par semaine, et pendant plusieurs années. Nous voilà, me voilà, installé à sa place – intenable – réalisant le désir infantile et mégalomaniaque d’une double identification : acquérir sa puissance en tant qu’il fut notre analyste et être analyste comme il l’est. Dans tout travail analytique – et là s’estompe la différence artificielle entre analyse thérapeutique et analyse didactique – l’analyste offre à son patient la passion de l’inceste et l’analysant souhaite advenir à la position où son analyste est parvenu : être à son tour analyste. Il n’y a là rien d’innocent. La longue expérience de frustration subie, acceptée, revendiquée, pendant notre propre cure, nous voilà en situation de l’offrir ou de l’infliger à ceux qui, à leur tour, nous abandonnent leurs cœurs nus. Quelle tentation ! Combien devons-nous veiller, pendant chaque séance, et à toute minute de celle-ci à ne pas « rendre » au sens de vomir, mais aussi d’aimer et de restituer à nos analysants ce que nous avons reçu et qui nous a été refusé dans notre propre parcours analytique. Je ne peux taire l’analogie qui s’impose à moi, sans être en mesure de l’asseoir théoriquement : une psychanalyse est une histoire d’amour, d’amour déçu.
Cette déception que nous avons vécue, ce renoncement toujours présent en nous, nous voilà placés en un lieu où nous pouvons les faire subir et aimer – car la pulsion se renverse, n’est-ce pas – aux usagers de notre cabinet de psychanalyste. Quelle attention délicate et humaine, quel effort permanent sont nécessaires pour combattre ce démon qui nous habite de rendre à celui qui n’en peut mais œil pour œil, dent pour dent, interprétation pour interprétation, silence pour silence, frustration pour frustration, chacun venu d’un ailleurs qui ne le concerne pas.
Il n’est pas là pour cela, pas plus que nous ne le fûmes mais il est exposé aux mêmes dangers que nous avons fréquentés aussi. Il est grand, il est toujours présent le risque de rejouer avec chacun de nos analysants les drames et les extases de notre propre analyse. La compulsion de répétition, assortie du retournement en son contraire, trouve là un terrain privilégié. Impavidus in proelio disait César. Le sommes-nous vraiment ? Et cette impavidité ne travestit-elle pas, sous les oripeaux rassurants d’un protocole réglé, nos propres faiblesses non analysées ? Je laisse la question ouverte et chacun qui exerce l’art de la psychanalyse y apportera sa propre réponse. Peut-être aussi ses réponses différentes variant avec ses patients, chacun unique, et les moments de sa vie, chacun particulier. Le temps est venu sans doute de dynamiter la statue assise du psychanalyste auquel seraient épargnés les chagrins de la vie et les trahisons de son corps. Et comment nier que ces attaques et ces blessures, comme aussi ses embrasements dans la création et la tendresse puissent être sans effet sur son humble travail quotidien ? Le psychanalyste endeuillé par la perte d’un être cher, la désillusion d’un idéal, ou illuminé par une passion qu’elle soit celle d’un créateur, d’un amoureux, d’un chercheur, demeure-t-il le même dans sa relation à ceux qui habitent son divan et peuplent sa psyché ? Au risque d’être iconoclaste je ne le crois pas, même si chacun de nous s’essaie à protéger l’area sacra du dialogue analytique. Les pulsions sont là, les pulsions poussent à la roue, les affects nous brûlent, et quoique nous en ayons, cela ne peut que retentir sur notre écoute analytique. Un simple rhume la modifie déjà et comment pourrions-nous prétendre que les aléas de notre vie intime, toujours liés à notre propre expérience analytique, demeurent sans effet de sens ? Il me paraît honnête de formuler sans fard que la psychanalyse a – ou doit avoir – un visage humain, et que le psychanalyste, loin d’être protégé par sa propre expérience du divan, est plus exposé encore que quiconque, et donc vulnérable, et qu’il n’en finira jamais avec les comptes qu’il règle, par patients interposés, avec les résidus transférentiels de sa propre analyse, elle-même réactualisant sa névrose infantile, dans un cycle sans fin que ses analysants rejoueront à leur tour.
Là, se trouve posé le problème de la filiation qui ne saurait être qu’une question et non une réponse, et c’est peut-être mieux ainsi dans la mesure où il est le miroir de l’interrogation sur la mort, qui elle-même obéit aux mêmes mystérieuses lois de l’incompréhensible et de l’insupportable.
Le contre-transfert contre la psychanalyse et l’institution psychanalytique. Entre la révolte et la soumission, mouvements infantiles que nous épousons tous, selon les humeurs du moment, à ce qu’a été notre propre parcours analytique, il y aurait sans doute une voie différente qui, étayée sur l’identification, la sublimation et la création personnelle conduirait le psychanalyste a être lui-même, dans une liberté inventée chaque matin, et raffermie chaque soir par le travail du jour, et nourrie chaque nuit par celui du rêve. Cassandre du passé et du présent, sans obérer un avenir à créer, je crains que cela ne soit pas le cas général et qu’à travers les aléas du « parcours du combattant » dans lequel s’est travesti notre chemin, parfois traversier, de psychanalyste dans sa formation – et aussi espérons-le dans sa déformation – nous avons tous été au risque, au demeurant jamais écarté, de déplacer subtilement notre transfert contre-transférentiel envers notre analyste, ce qui est différent bien sûr du transfert négatif à son égard, en une contre attitude s’opposant non au corpus scientifique et théorique de la psychanalyse, mais aux institutions qui le transmettent et aux hommes ou femmes en situation de pouvoir qui le parlent.
Là, plane le fantôme de Sigmund Freud. J’ai, bien des fois, exprimé mon sentiment profond qu’un psychanalyste de la fin de ce vingtième siècle ne pouvait advenir comme femme ou homme, artiste du désir psychanalytique, que s’il avait préalablement fait le deuil de l’héritage freudien, non dans son immense champ de réflexion et d’hypothèses à toujours réactualiser, mais dans le dogme d’idéologie à la limite religieuse qui relie tous les psychanalystes à la personne de Sigmund Freud et à son œuvre. Je crois intimement que la vraie fidélité est là, dans la mise en interrogation de textes dont les plus récents ont presque un demi-siècle d’âge, alors que notre société se fracture, que nos patients présentent à notre écoute et compréhension des organisations différentes, que le socius psychanalytique s’institutionnalise et donc se fossilise inévitablement, en même temps que le champ conceptuel d’où la psychanalyse peut aspirer sa renaissance s’étend indéfiniment. Là n’est pas en question le travail révolutionnaire du fondateur de la psychanalyse. Simplement est interrogée la position de ceux qui demeurent fixés à ses hypothèses, et à leurs épigones, refusant d’intégrer dans leur territoire de pensée les acquisitions nouvelles de sciences anciennes comme la psychophysiologie, l’ethnologie, la sociologie, l’économie politique ou les découvertes actuelles de sciences elles-mêmes récentes comme l’éthologie, la sémiotique, la cybernétique, l’automatique, la mathématique contemporaine et bien d’autres. Pour revenir à ce qui est l’argument d’une contribution à cette réflexion il y a bien là des raisons de nommer le contre-transfert à l’égard de la psychanalyse et des figurations dans lesquelles elle se cadavérise parfois dans le culte d’un défunt qui sans aucun doute s’insurgerait contre ce qu’il n’est pas possible de ne pas considérer comme une régression à un point de fixation.
La vérité du psychanalyste d’aujourd’hui peut sans doute se fonder dans sa relation au patient qui vient à lui, dans le trouble de ses émois, sa tendresse en perdition, sa pensée inhibée ou à l’inverse luxuriante dans son improductivité, sa vie désorganisée par des mouvements pulsionnels qu’il ne maîtrise pas plus qu’il ne les comprend, et qui se dissolvent dans des structures mentales que la conceptualisation freudienne ne nous permet pas d’appréhender suffisamment. Là, apparaît un nouveau danger dans l’irruption éventuelle – mais non rare – d’un mouvement transférentiel incompris, parce que non senti et non élaboré par l’analyste, que nos cadres et référents théoriques ne nous permettent pas de contenir, travailler et restituer. Nous, psychanalystes de la révolution post industrielle et du maintien de la cellule familiale, avons été élevés dans la mythologie du difficile chemin qu’Oedipe parcourut entre Corinthe, Thèbes et Delphes, dans un registre essentiellement triangulaire. Mais les antianalysants (Joyce Mac Dougall), les hyper-analysants (R. Cahn), les structures opératoires psychosomatiques (P. Marty et M. Fain), les états limites (J. Bergeret) pour s’en tenir à des psychanalystes scrutant la psychopathologie psychanalytique française, ou même ouest-européenne, sont des patients qui nous offrent et dérobent l’étrange masque de Narcisse déformé par le miroir des eaux dormantes et mouvementées où il se reflète, séduit et pétrifié par cette image, et insensible aux cris désespérés d’amour d’Echo.
Sommes-nous assurés d’échapper à cette fascination, installés comme nous risquons de le devenir dans une position elle-même profondément narcissique, sourds aux cris de souffrance qui montent vers nous et seulement préoccupés de notre belle image, conforme aux « standard » que nos sociétés attendent de nous ? Et tous ces patients issus d’une pathologie nouvelle dans son organisation relativement désorganisée, qui nous interpellent avec des mots, des affects et des pensées qui ne sont pas ce que nous avons appris, ne nous placent-ils pas en position de cécité-surdité par les risques qu’ils nous font courir, à la fois en nous vampirisant par une avidité orale inassouvissable, et en nous envahissant par une tentative, pour eux désespérée, et pour nous désespérante, de maîtriser, contrôler et coloniser notre propre fonctionnement mental, seule issue pour eux d’une impasse dans laquelle les relations ambiguës et ambivalentes d’une éducation où s’effacent les différences entre les sexes et les générations les ont incarcérés ? A ces hurlements parfois silencieux, rarement tonitruants, le plus souvent inaudibles ne devons-nous pas offrir un aggiornamento d’une écoute plus disponible, moins enfermée dans ses carcans théoriques, ouverte aux innovations créatrices ?
Sommes-nous vraiment incapables de faire ce pas décisif, qu’ont franchi sans rechigner les psychanalystes de psychotiques, qui acceptent de livrer à l’autre – le dolent − la part de chair qu’exige Shylock ? Là encore, je crois que nous avons plus à gagner qu’à perdre et, ce qui est beaucoup plus important, que nos patients trouveront alors des réponses pertinentes à leurs questions informulées. Sans doute l’exercice psychanalytique est-il au prix, face au déferlement de toutes les thérapies du corps, par le corps, pour le corps, de groupe, d’expression, de devoir redéfinir son champ sans altérer la pureté de sa démarche. Dans l’acceptation d’une dimension nouvelle, élargie, accueillante, disponible du contre-transfert réside peut-être une condition de la survie de la Psychanalyse et une certaine émotion intime dans la gravité d’un moment d’une réflexion qui cherche à tracer les formes dans lesquelles le travail psychanalytique contemporain, au prix d’un réel et profond effort de remise en question du travail intime de pensée du psychanalyste, peut trouver les conditions de sa renaissance et d’un nouvel épanouissement.
*
Tout ce qui précède visait à mettre en mots comment le contre-transfert joue à rendre périlleuse l’activité psychanalytique. Mais aussi, comme je l’annonçais au début de cette contribution, le contre-transfert est un « plus » pour le travail du psychanalyste, dans la mesure précisément où il lui sert de radar, de repère, d’indicateur – y compris au sens trivial du terme – pour mieux entendre des paroles inconnues de lui. A laisser naître en nous des affects imprévus, des pensées insolites, des associations incongrues, à être disponibles à l’imprévisible, nous pouvons entrer dans des problématiques nouvelles, et passionnantes, qui élargissent le champ psychanalytique, et étendent sa dimension humaine. Certes, il est nécessaire que nous gardions le contrôle de ces mouvements pulsionnels qui s’opèrent dans notre psyché, et quasiment à son insu, que nous nous efforcions de concevoir les super-structures métapsychologigues qui peuvent les élaborer, que nous demeurions aptes à contenir, reconstruire et éventuellement restituer au moment opportun tous ces matériaux. Mais quel champ de découvertes nous est ainsi offert, et quelles archéologies demeurent par là à déchiffrer !
Le métier de psychanalyste n’est pas celui d’un fonctionnaire de l’inconscient trinitaire, mais d’un aventurier sérieux lucide et compétent des terres vierges et des continents noirs à explorer. Ils sont naturellement nombreux. Ils imposent que nous adaptions le protocole à ce que nous-mêmes acceptons de sacrifier de 1’« or pur » analytique. Mais, dans la mesure où nous faisons le choix – qui est le mien assurément – d’être présents à la souffrance et à la détresse, sans renier en quoi que ce soit les enseignements fondamentaux de notre art, dans celle aussi où nous sommes prêts à nous laisser partiellement et temporairement envahir, déborder par des passions que nous ne comprenons pas instantanément mais qu’il est essentiel d’élaborer ensuite rapidement, nous créons les conditions d’un nouvel espace de liberté pour des analysants que Freud n’a pas connus. Et qu’est-il de plus important dans l’héritage de notre maître que ce goût, dont toute sa vie porta témoignage, pour la liberté, celle d’inventer, de changer, de modifier les superstructures théoriques et les procédures technologiques à la lumière du vif et de l’apparemment mort ? Je n’indique certainement pas là que tous les exilés d’une certaine homéostasie psychique, que tous les souffrants relèvent d’un traitement psychanalytique. Je pense simplement qu’à situation nouvelle, il y a réponse nouvelle. Et que, tout en demeurant dans le cadre d’un protocole analytique aménagé, sans céder à aucun des modes du laxisme contemporain, les psychanalystes ont à travailler assidûment sur leur contre-transfert pour se trouver mieux en capacité d’entendre des plaintes et des récriminations auxquelles ils n’avaient pas l’habitude de se frotter.
Pour cela, l’élaboration du contre-transfert va se révéler un puissant outil thérapeutique, laissant venir à la psychanalyse des sujets à qui elle était interdite, que ce soit sur le divan ou dans le fauteuil. Laissons la procédure aux procéduriers, sauvegardons l’essence du processus – soit la séquence transfert, résistance, interprétation – et rendons-nous disponibles à voir en nous ce que des patients nouveaux nous rendent de ce que nous refusons. Il y a bien longtemps que Winnicott nous éclairait sur la « haine dans le contre-transfert ». Mais cette pensée téméraire doit aujourd’hui se colorer de bien des variantes : la dérision, le mépris, l’invalidation, la déformation, l’ironie qui nous conduisent à écarter les patients gênants. Je demeure persuadé que très peu parmi nos consultants – et sans doute la proportion ne peut que décroître dans l’affadissement des valeurs traditionnelles d’une société, que l’on s’en réjouisse ou que l’on le déplore, qui se transforme – entrent dans le cadre classique d’une cure psychanalytique telle que nous avons appris à la conduire, ou l’accompagner.
Par contre, est immense le champ des errances douloureuses d’êtres en dérive dont le fonctionnement mental n’est ni clairement névrotique, ni franchement psychotique qui pourraient bénéficier d’un travail analytique qui requiert certes un aménagement du protocole mais surtout une plongée en nous, vrillant nos certitudes théoriques, nos habitudes pratiques, tellement pratiques ! et nos traditionnels modes de pensée. Le colloque dont il est rendu compte dans cet ouvrage nous a conduit, comme l’indique judicieusement Didier Anzieu, à « revisiter » le contre-transfert. Il me permettra sans doute d’exprimer le souhait qu’au-delà de cette nouvelle exploration se dégage la perspective d’une véritable révision. Une vision nouvelle, où le contre-transfert, plus qu’une défense contre ce qu’agitent en nous les émois des patients, contre ou pour ou avec ce qu’il nous permet de comprendre de son fonctionnement, s’élargit à une acceptation d’une souffrance inconnue infligée par l’autre en ce qu’il interroge les zones obscures de notre propre chaos soigneusement protégé par notre fonction, notre statut et notre rôle. Une telle démarche ne va pas sans effort ni sans déception, dont je ne pense pas que nous puissions faire l’économie. Ni sans échec aussi, comme en connut si souvent Freud, échecs dont il sut merveilleusement faire les leviers d’une avancée théorique nouvelle.
*
Pour terminer, je voudrais vous livrer une brève histoire, tirée d’un album de Lucky Luke, sur les aléas du contre-transfert, et une apologie de la déception dont il a été bien souvent question dans ce texte.
La guérison des Dalton, de Morris et Goscinny (éditions Dargaud), raconte l’histoire singulière du professeur Otto Van Himbeergeist, criminologue de formation psychanalytique, qui défend la thèse de la réhabilitation possible des délinquants à partir de la reconstruction de leur roman familial infantile : « Je maintiens que tous les criminels sont des malades susceptibles de guérison. Il y a toujours dans leur passé, leur petite enfance, un événement qui les a poussés dans la voie de l’illégalité ». Après nous avoir présenté des vignettes cliniques caricaturales mais non inexactes sinon innocentes de ses collègues et des responsables de la Sécurité, le professeur parvient à obtenir le droit de soumettre à un traitement psychanalytique les frères Dalton, sous le contrôle sceptique de Lucky Luke et franchement ironique de Jolly Jumper, le cheval qui interprète plus vite qu’il ne pense. Sa curiosité, son épistémophilie sont excitées par ces « irrécupérables » que sont les quatre frères Dalton, dont la pathologie se distribue de l’avidité orale insatiable d’Averell au sadisme anal illimité de Joe, dans une identification intriquée, érotique et agressive au Père, célèbre « braqueur » de banques et à la Mère, « suffisamment bonne » pour ses fils d’une aventure perdue, obligeant les banquiers dévalisés à chanter des cantiques pendant les hold-up perpétrés pas ses garçons.
Quand Luke, devant une expérience quasi comportementale que veut tenter le professeur en fournissant aux frères Dalton « guéris » armes et chevaux indispensables à une de leurs habituelles opérations, tente d’introduire un élément de réalité sur la dangerosité d’une telle aventure, le contre-transfert du professeur vacille une première fois : « Ne me dites pas à moi qui est fou ! Moi, je sais qui est fou et qui ne l’est pas ! », ajoutant curieusement, à l’adresse de Lucky Luke : « C’est fou que de me dire que je suis fou ». Que de délices pour Searles s’il lisait cette histoire !
Et là, tout bascule. La névrose infantile du professeur, nourrie de sublimations intellectuelles, scientifiques et thérapeutiques visant à barrer ses pulsions orales et sadiques anales, se trouve réactualisée par les acting qui ne sont ni in ni out des frères Dalton dont il partage désormais les activités criminelles introduisant simplement dans le style et l’efficacité des opérations, la subtilité de son propre fonctionnement psychique. Et l’on voit ainsi le thérapeute de criminels devenir chef de bande, dans un compromis névrotique où il met au service de ses instincts pervers la connaissance qu’il a du fonctionnement mental de ses victimes. Cette historiette significative à tant d’égards en ce qu’elle est proposée, dans une large diffusion, à de jeunes adolescents et aussi sans doute à des adolescents quinquagénaires, ne doit-elle pas nous interroger en ce qu’elle place au centre d’un débat public le risque toujours présent d’une identification totale et sans distance du thérapeute à son patient, analogue au mouvement contemporain qui conduit les adultes, parfois vieillissant à intégrer les modes de leur progéniture, dans des exhibitions d’habitus, de vesture, et de comportements où ils s’assimilent, dans la négation et de la différence des sexes et de celle des générations, aux imagos et aux fonctionnements immatures de ceux-là même qui recherchent en eux, parfois avec désespérance, une image d’identification adulte ?
Je limiterai mon commentaire de cette illustration clinique, très largement populaire, à une question : sommes-nous, psychanalystes de ce temps, à l’abri d’une telle perversion de notre contre-transfert en face ou au chevet de patients qui nous proposent des identifications contre-transférentielles tellement séduisantes parce qu’apparemment libérées ? Je laisse au lecteur le soin d’y réfléchir et d’y répondre.
Le champ de travail du psychanalyste est le territoire de la haine et aussi de l’amour, tous deux déçus. De là ne peut naître qu’une déception, sans doute elle aussi puissant moteur du travail du psychanalyste, sur laquelle je m’autorise quelques variations, en guise de conclusion sans conclusion :
La déception est la mesure de notre finitude et le témoignage des reliquats de notre mégalomanie infantile.
La déception est la rencontre vraie de la castration.
La déception est l’étayage de l’idéal du moi.
La déception est la marque inéluctable de la défense et de l’interdit.
La déception est la compagne absolue du narcissisme.
La déception est l’acceptation de l’écoulement du temps et du plaisir différé.
La déception est la révérence que le rêve et le fantasme font à la réalité.
Le risque de la déception est la condition nécessaire du désir, non de la pulsion, et en cela il est la marque de la condition de l’homme.
La déception est le fondement de l’altérité. Il n’y a pas de déception dans la solitude.
La déception est la nécessité tragique d’une existence.
La déception est l’éloge de la lucidité.
La déception est ce moment incertain et fragile mais fondateur où peut se transcender l’échec ; en cela, elle est la condition de la réussite, de la recherche du renouveau, la condition de mon dépassement.
La déception est le contraire du désespoir, en ce qu’elle est jumelle de l’espérance.
La déception ne s’éprouve pas à basse altitude, « rien ne traduit tant son vulgaire que le refus d’être déçu » (Cioran).
La déception est inconnue aux indulgents d’eux-mêmes comme aux suffisants.
Mais la déception est la nécessité de l’artiste, du créateur et de l’amoureux, donc du psychanalyste.
La déception est le but ultime de la séduction.
La déception est la rançon de la passion et le prix de la ferveur.
La déception est le mouvement naturel de l’intelligence.
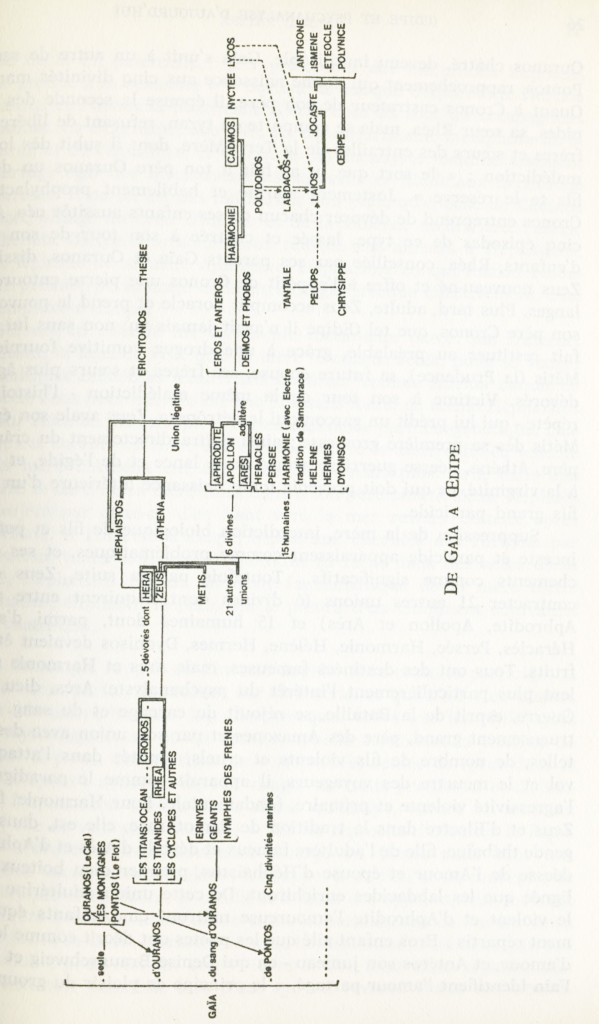
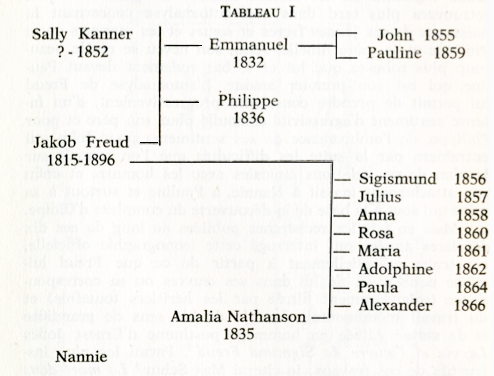
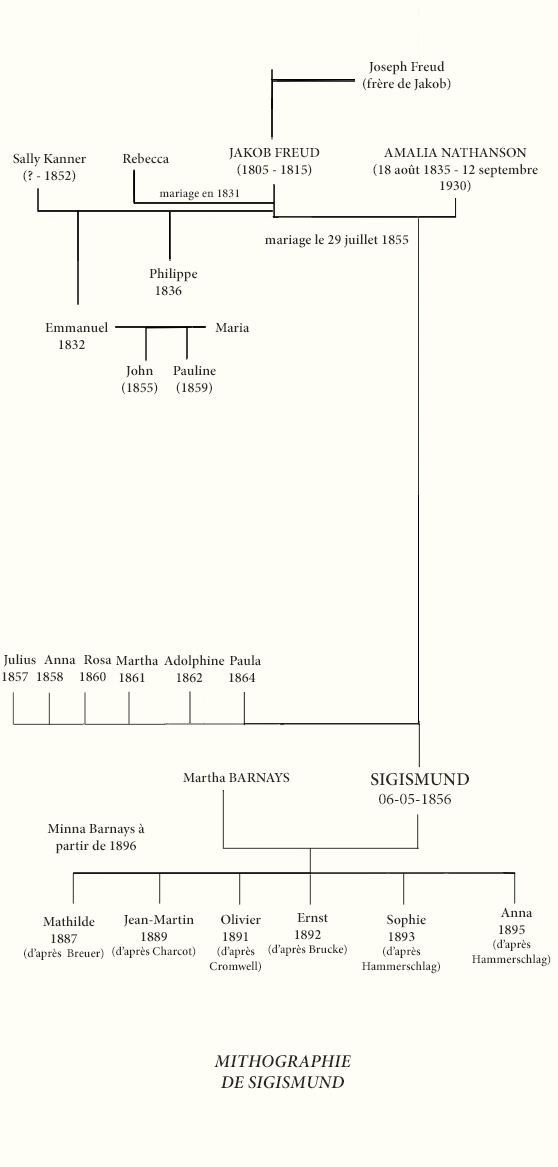
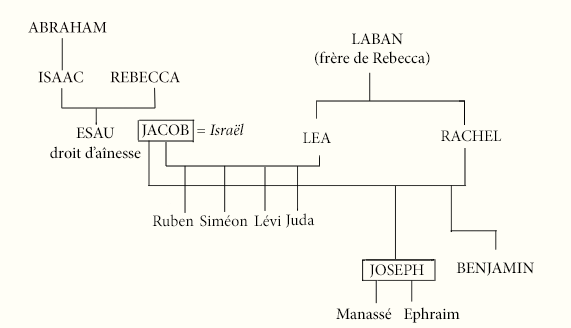
Les contraintes exposées, certaines devinées dans ce témoignage, laissent entrevoir un « soignant » raidi dans une armure d’acier psychanalytique. A l’intérieur vit un être doutant, souffrant, rêvant, aimant. Craintif encore et courageux cependant? Mendiant un peu de considération pas plus?Quelles portes ouvertes! Qui en a douté ?
Cet acier-là était-il nécessaire, vous demandez-vous ? Nous livrer votre questionnement est d’une grande générosité, d’une belle fraternité. J’ai pris grand intérêt à sa lecture, même si j’ai eu quelque mal à suivre la généalogie de tous ces Dieux de l’Olympe !Puis, certains concepts sont assez théoriques pour moi. Ce que vous nous apprenez de la famille de Freud est hallucinant. J’aurais aimé en savoir davantage sur la relation de Freud avec sa mère. Quelles ont été leurs relations lorsqu’il est devenu « adulte » ? Le sait-on ?
Ce texte a été écrit il y a quelques temps. Aujourd’hui croyez-vous que les psychanalystes ont une place méritée dans notre société ? Qui a recours à leurs soins ?
« Il faut être absolument moderne. » depuis des décennies, et pour toujours ! Sans perdre la raison!
Je vous remercie de nous rappeler cet aphorisme d’Arthur Rimbaud, tout à la fois moqueur, ironique, caustique, facétieux, frondeur, goguenard, mordant, narquois, piquant, railleur ou ricaneur…
Y a-t-il tellement de moquerie dans cet aphorisme ? C’est ainsi que vous le ressentez. Je n’ai pas lu tout Rimbaud, loin de là. Tout ce que j’ai lu de lui, se traduit chez moi, comme pour d’autres personnes, par des images, parfois même de grands tableaux, des pastels imprécis, effacés dans un coin, des collages inattendus vibrants de complémentarités, des acryliques contrastés, nuancés, éclairés savamment, pourquoi pas, sophistiqués. Je vois des fleurs, des déesses, des paysages, des précipices, des femmes noircies, transpercées. Comme des Klimt, des Kokoschka, des Bruegel…du Munch. Pour les poèmes d’Arthur Rimbaud « je vois », ou je dessine dans ma tête en essayant de ne pas résister. Je n’y sens aucune raillerie. D’autres je sais, les traduisent en musique, et encore en beaux textes apprivoisés, compréhensibles.
Pour ce qui est de votre exposé sur Œdipe, (qui n’était pas un Dieu, mais notre fatalité), sur Freud (qui nous a libérés, mais la liberté est un carcan, le savions-nous ?) sur votre pratique, (témoignage généreux et fraternel), je me suis fait ma bande dessinée. Est-elle caricaturale ?
Lorsque j’étais élève en quatrième, au collège de Moissac, nous avions un professeur de dessin, qui pratiquait une pédagogie motivante, Madame Banabéra, Dieu ait son âme. Elle nous avait proposé un jour de dessiner chacune, notre voisine de table. Ma camarade était jolie comme un cœur, le visage rond, les joues colorées, les yeux gourmands. Sans réfléchir, j’ai dessiné une pomme, toute réjouie, rouge des deux côtés. Exclamations, rires. Madame Banabéra est arrivée, m’a arraché la feuille des mains, que je voulais lui soustraire, craignant une réprimande, l’a considérée, et m’a félicitée ! Puis elle nous a fait un cours sur le portrait bien sûr. C’est avec elle aussi que nous sommes allées au cloitre un autre jour et avons dessiné des chapiteaux. Ah ! Ces feuilles d’acanthe ! Une autre fois elle nous a fait dessiner un chien abandonné, apeuré, qui courait dans la cour…mais c’est une autre histoire incongrue ici.
« La déception est le but ultime de la séduction. » (Ou le résultat ?)Comment comprendre cela ?
Je vous remercie pour votre témoignage et votre contribution mais je maintiens mon interprétation.
Il y a quelques années maintenant, à ma première lecture des écrits freudiens je n’ai pas tout compris, loin de là, mais il m’est apparu comme une évidence que les pathologies psychiques sont des maladies d’amour.
« Une psychanalyste est une histoire d’amour, d’amour déçu », écrivez-vous si justement. Et vos variations sur la déception me donne à penser sa naissance dans la psychanalyse de ces patients que Freud n’a pas connus comme un moment mutatif et maturatif.
Pour certains ce sera, non pas cette déception, mais la tristesse. Une tristesse tellement profonde ! Une tristesse inconnue, inaccessible lorsque ne pouvaient s’exprimer que la colère, la rage, la haine.
Oui la tristesse n’est pas la dépression, ni la déception. Tristesse des manques du passé, tristesse du non accomplissement du présent, tristesse de l’inéluctable à venir.
Mais aussi cet affect triste est un moteur pour relire le passé en le coloriant autrement, vivre le présent avec une énergie retrouvée et aller vers l’avenir, tous les avenirs, avec sérénité et détermination.